Sans autorisation officielle, à l'initiative personnelle, l'auteur de ce blog publie une copie du texte
«Bilan du Président A. Bouteflika 1999-2014»
ci-dessus
joint. Ceci après que le site en question ait été piraté par des agents
experts au service de la subversion politique et de la fraude
historique qui regroupe ses forces autour du candidat Benflis (*).
Le
document "Bilan" étant gênant pour les ennemis de l'Algérie au vue de
son contenu pertinent et de son pouvoir thérapeutique de réanimation de
l'opinion victime de l’amnésie distillée par la propagande et l'intox
étrangères et locales. La vérité les dérange, les irrite, leur fait perdre la face !
Au lecteur de constater de visu et de
pondérer les faits chiffrés qui annihilent les mensonges et les
promesses idyllique de cette "colonne" hostile à l'Algérie et à la publication de la vérité.
Bilan du Président A. Bouteflika 1999-2014
I- Consolider la Paix sociale
Eu égard aux engagements pris devant la Nation, le président
Bouteflika avait enjoint le gouvernement de parachever la mise en œuvre
de la Charte pour la paix et la réconciliation afin de permettre,
parallèlement à la lutte contre le terrorisme livrée par les forces de
sécurité notamment l’ANP, de libérer les initiatives et consacrer les
efforts aux autres questions cruciales de développement.
Plébiscitée par référendum du 29 septembre 2005 avec 97,38% de «oui»,
la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale est destinée à
consolider définitivement la paix et la sécurité exigées aujourd’hui
pour la mise en œuvre d’une démarche nouvelle visant à concrétiser la
réconciliation nationale et apaiser les stigmates de cette tragédie.
Pour rappel, cette démarche traite les cinq points suivants :
- Reconnaissance de la part du peuple algérien à l’égard des artisans
de la sauvegarde de la République Algérienne Démocratique et Populaire
- Mesures destinées à consolider la paix
- Mesures destinées à consolider la Réconciliation nationale
- Mesures d’appui à la politique de prise en charge du dossier complexe des disparus
- Mesures destinées à renforcer la cohésion sociale
A cet effet, différents dispositifs ont été mis en œuvre, notamment :
- les mesures d’appui à la politique de prise en charge du cas des disparus ;
- l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme ;
- les mesures de réintégration ou
d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures
administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie
nationale.
Bilan
La réconciliation nationale est devenue une réalité palpable. Au 31
juillet 2008, elle a a mobilisé une enveloppe financière globale de 22,6 milliards de DA avec un montant d’indemnisations versées de 6,634 milliards de DA pour les trois dispositifs mis en œuvre.
A - Mesures d’appui de la politique de prise en charge du cas des disparus
Au 31 juillet 2008, l’application de ce dispositif a concerné :
– 8 023 cas de disparus recensés ;
– 15 438 personnes reçues par les commissions de Wilayas ;
– 371,45 millions de DA d’indemnités versées au titre du capital global ;
– 5 704 dossiers ont été acceptés dont 5 579 définitivement réglés ;
– Montant des indemnisations versées aux ayants droit :
- capital global : 371,45 millions de DA.
- pension mensuelle : 1,32 milliards de DA.
En plus, 858 psychologues ont été recrutés pour la prise en charge
des enfants touchés par la tragédie nationale, un programme de 100
logements par wilaya au profit des veuves avec enfants a été initié et
des postes de travail sont offerts à leurs ayants droits chômeurs.
Concernant les dossiers rejetés, au nombre de 934, les principales causes de rejet sont :
– la non-compétence territoriale ;
– le fait que le nom de l’intéressé figure sur la liste des décédés dans les rangs des groupes terroristes ;
– la recherche du disparu par les services de sécurité toujours en cours ;
– les ayants droits sont déjà indemnisés dans le cadre des victimes de terrorisme ;
– absence d’ayants droits légaux ;
– disparition non liée à la tragédie nationale.
B - Aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par
l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme (décédé dans les
rangs des groupes terroristes)
Les personnes dont un ou des proches ont choisi une voie condamnable,
ne sauraient être tenues pour responsables des erreurs et errements
d’autrui. Afin d’écarter le risque de voir exclues des familles éplorées
par la tragédie nationale, des dispositifs ont été mis en place pour
aider les familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs
proches dans le terrorisme.
Au 31 juillet 2008, l’application de ce dispositif a concerné :
– 17 969 cas de décès dans les rangs terroristes recensés ;
– 18 945 personnes reçues par les commissions de wilaya ;
– 12 646 dossiers examinés et 139 en instance ;
– 7 702 dossiers définitivement acceptés ;
Montant des indemnisations versées aux ayants droits :
• capital global : 3,38 milliards de DA
• pension mensuelle : 523,93 millions de DA.
Concernant les dossiers rejetés, au nombre de 4.805, les principales causes de rejet sont :
– la non-compétence territoriale ;
– enquête sociale défavorable (revenu mensuel supérieur à 12.000,00 DA) ;
– les ayants-droits sont déjà indemnisés pour un autre proche décédé dans les rangs des groupes terroristes ;
– les recherches sont restées infructueuses.
C- Réintégration ou indemnisation des personnes ayant fait
l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à
la tragédie nationale
Au 31 juillet 2008, l’application de ce dispositif a concerné :
– 20 511 personnes reçues par les commissions de wilaya ;
– 9 861 dossiers examinés ;
– 5 430 dossiers avec avis favorable acceptés qui ont abouti à 1 368 avis favorables pour réintégration et 4 008 avis favorables pour indemnisation ;
– 1,038 milliard de DA d’indemnités versées aux intéressés ;
–36 dossiers en instance.
Durant la période 2009-2014
- le Ministère de l'Intérieur et les représentants de la garde
municipale qui avaient un grand rôle dans le retour de la stabilité et
de la sécurité en Algérie, entament des négociations
- En février 2014, un décret a été publié portant indemnisation
des femmes violées en tant que victimes de la tragédie nationale et
l’envoi du décret exécutif en instructions incluant l'indemnisation des
victimes du terrorisme par décrets de 1997 et modifiée complémentée en
1999. 10 000 femmes sont concernées par cette disposition, elles ne
seront plus contraintes de fournir un certificat médical
attestant de leur viol, seule une attestation des services de l’ordre
suffit. Les femmes concernées seront recensées en fonction de leur
dossier déjà déposé au niveau des comités chargés du dossier.
II – Construction de l’Etat de Droit et amélioration de la Gouvernance
Durant ses trois mandats, le président Bouteflika s’est fixé
comme objectif l’instauration dans les institutions et l’économie du
pays des règles et des normes de fonctionnement et d’interactions
modernes permettant au pays de s’intégrer harmonieusement à son
environnement immédiat et à la communauté internationale. La bonne
gouvernance est synonyme de modernisation, de stabilité, de
développement et de prospérité dans la justice et l’équité.
La Consolidation de l’Etat de droit est un défi
qui doit engager activement toute la société, dont l’ultime objectif
reste l’accomplissement du processus démocratique dans le pays. Depuis
1999, cinq directions principales ont été privilégiées.
1er : renforcement de l'État légal qui impose la loi et se soumet lui-même à la loi.
2e : légitimation des institutions élues
et des pouvoirs établis par des élections régulières qui ont donné,
nonobstant les taux de participation, les assemblées les mieux élues
depuis l'indépendance.
3e : proximité, comme méthode de gouvernance.
Le présidentBouteflika multiplie ses sorties sur le terrain pour
s’enquérir, au plus près, de la mise en œuvre et des effets sur les
populations des politiques publiques qu’il a engagées.
4e : Mise en chantier de la réforme des structures et des missions de l'Etat,
à travers des mesures visant à améliorer les prestations du
service public, démocratiser les conditions de leur accès et
rationaliser les modes d'intervention des collectivités locales.
5e : Réforme de la justice, complexe
processus évolutif qui a été érigée en priorité nationale par le
président Bouteflika. Socle de la bonne gouvernance, la justice a été au
centre du programme du Président en lui consacrant près de 379
milliards de DA. Ce financement est dédié à la réalisation de 110 cours et tribunaux, d’écoles de formation et plus de 120
établissements pénitentiaires afin de développer les infrastructures du
secteur. D’importants progrès ont été enregistrés en matière de mise
aux normes universelles, la formation du personnel, la
modernisation de l’appareil judicaire et la réforme pénitentiaire.
6e : Lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent. Contre ce fléau persistant,
le Président Bouteflika a mis en place l’organe national de lutte
contre la corruption et élargi l’obligation de déclaration du
patrimoine.
7e : Amélioration des prestations du service public en démocratisant les conditions de leurs accès et en rationnalisant les modes d’intervention des collectivités locales.
9e : Lutte contre la bureaucratie, un
chantier lancé durant le mandat 2009-2014 avec la création d’un
ministère-délégué chargé de la Réforme du service public et
l’informatisation du fichier national de l’Etat civil permettant à tout
citoyen où qu’il se trouve d’obtenir son acte de naissance sans avoir à
se déplacer vers la commune de son lieu de naissance.
10e : Renouveau du secteur des Finances durant la période 2010-2014, avec plus de 295 milliards de DA destinés à la réalisation de 250 structures des impôts, de 70 structures du Trésor, 50 structures des Douanes ainsi que de nouveaux services du cadastre.
11e : Commerce et régulation ont
fait l’objet d’un processus de modernisation et de renforcement des
services et des moyens de contrôle ainsi que de la réhabilitation de
plus de 250 marchés de gros et de détail avec une enveloppe budgétaire
de près de 39 milliards de DA allouée au secteur. Un autre budget de 58
milliards de DA a été destiné au renforcement et la modernisation des
moyens de contrôle et de régulation pour l’administration du travail. De
2009 à 2013, des centaines d’infrastructures administratives et de
services de proximité et de prestations sectorielles ont été réalisées,
alors que des centaines d’autres sont en cours de réalisation.
III – Poursuite du développement des secteurs vitaux
Pour la première fois depuis son indépendance, l’Algérie peut
aspirer à maintenir son élan de développement en dépit d’une crise
économique mondiale que nul ne peut ignorer. Pour ce faire, il est vital
de valoriser au mieux les moyens et les atouts du pays pour résorber
les déficits sociaux, mais aussi construire une économie diversifiée,
source de revenus additionnels à ceux des hydrocarbures.
Le Président Abdelaziz BOUTEFLIKA
Agriculture
Dans le domaine de l’agriculture, une stratégie de développement
durable a été élaborée en 2006 (Renouveau Rural) et en 2008 (Renouveau
de l’Economie Agricole). Le Renouveau de l’Economie Agricole
(2009-2013), en tant que stratégie nationale de développement durable de
l'agriculture, vise notamment le renforcement de la sécurité
alimentaire du pays. Cette stratégie s’articule autour des quatre axes
principaux suivants :
1- La promotion d’un environnement incitatif pour
les exploitations agricoles, les opérateurs de l’agroalimentaire et
d’une politique de soutien adaptée. 2- La mise en place de 10 programmes d’intensification des productions et des programmes spécifiques. 3- Le rajeunissement
des exploitants agricoles et le renforcement de leurs capacités
techniques, grâce à une dynamisation de l’appareil de formation, de
recherche et de vulgarisation. 4- La modernisation de
l’administration agricole et le renforcement des institutions publiques
concernées (administration forestière, services vétérinaires, services
phytosanitaires, labellisation…).
Pour donner une nouvelle chance aux petits producteurs qui en ont le
plus besoin, l’Etat a effacé la totalité de la dette des agriculteurs et
des éleveurs qui s'élevait à 41 milliards DA. Ce secteur a, par
ailleurs, bénéficié, par la suite, d’autres programmes d’aides, à savoir
: 1 - Des mesures d’aide par le biais des exemptions et allègements fiscaux sur certains intrants agricoles. 2 - La régulation de la distribution, entamée cette année pour la pomme de terre et qui sera élargie à d’autres produits. 3- L’amélioration de l’encadrement de l’agriculture en rendant ce secteur éligible aux bénéfices des emplois soutenus. 4 - L’encouragement
de l’investissement dans le secteur, grâce à la clarification du régime
juridique d’exploitation des terres agricoles publiques sous forme de
concession.
Durant la période 2009-2014, la stratégie de
développement durable entamée en 2006, s’est poursuivie à travers les
instruments mis en place à cet effet et visant le renforcement de la
sécurité alimentaire du pays. Aussi, près de 1 000 milliards de DA
ont été consacrés à la réalisation de plantations forestières sur 360
000 hectares, de plantations pastorales sur une superficie de 70 000
hectares et les plantations oléicoles sur 1 million d’hectares. Ce
budget a concerné le programme de développement de l’agriculture par
voie de bonification des prix des récoltes et de soutien à la
modernisation des techniques et moyens de cette activité.
Infrastructures d’Hydrauliques agricoles
Dans ce secteur, neuf projets ont été réalisés, portant sur des
aménagements hydro-agricoles, des équipements, des réhabilitations
d’infrastructures, des rénovations de canaux, des études de réalisation,
des travaux d’assainissement et de protection contre les crues, des
constructions de retenues collinaires, des travaux d’extension de
périmètres irrigués, etc., qui ont touché des dizaines de milliers
d’hectares.
Ressources en eau
En matière de ressources en eau, l’Algérie disposait en 2009, sur la base de projets lancés durant les premiers plans,
d’un parc de grands ouvrages de mobilisation de la ressource, composé
de 72 barrages (60 sont actuellement en exploitation) faisant passer la
capacité de mobilisation à 8,35 milliards de m3.
Le programme de dessalement d’eau de mer comprend, pour sa part, la
réalisation de 13 stations de capacités variables qui produiront à terme
2,26 millions de m3/jour. Les deux premières usines de ce programme
(Arzew et Alger) ont été mises en service en 2005 et 2008. Elles
s’ajoutent aux 23 stations monoblocs déjà fonctionnelles et réparties le
long des villes du littoral.
Dans le domaine de la mobilisation et de la distribution de l’eau
potable, de raccordements aux AEP et de la protection des ressources
halieutiques, les efforts consentis durant les cinq dernières années ont
permis d’enregistrer des améliorations notables.
L’apport financier de 2 000 milliards de DA a boosté ce secteur, en
vue de la réalisation de 35 barrages, 25 transferts, 34 stations
d’épuration et plus de 3 000 opérations d’alimentation en eau potable,
assainissement et protection des villes contre les inondations. A ce
montant, s’ajouteront 60 milliards de DA mobilisés sur le marché
financier pour la finalisation ou la réalisation de 8 nouvelles stations
de dessalement de l’eau de mer.
Durant la période 2009-2013, dix barrages ont été livrés, pouvant
mobiliser un total supplémentaire de 807 millions de m3. Il s’agit des
barrages de Douéra (W. d’Alger), de Kissir (W. Jijel), de Boussiaba (W.
Jijel), de Saf-Saf (W. Tébessa), de Bougous (W. El Taref), d’Ourkis (W.
Oum El Bouaghi), de Kerrada (W. Mostaganem), de Mahouane (W. Sétif), de
Draa Diss (W. Sétif) et du barrage de dérivation du Cheliff (MAO)
(W. Mostaganem).
En 2013, dix stations d’une capacité globale de production de 1,9
million de m3/jour d’eau potable étaient en exploitation. Les trois
autres sont soit en construction soit à l’étude. Une fois ce programme
achevé, le dessalement d’eau de mer fournira aux populations des villes
et villages du nord du pays plus de 2,3 millions de m3 d’eau
potable/jour.
Concernant les forages entre 2009 et 2013, il a été réalisé pas
moins de 702 forages représentant un linéaire de 146.380 ml et
mobilisant un débit global de 11.805,5 l/s soit 1,019 million m3/j.
En outre, six grands transferts ont été livrés, durant la période
2009-2013. Il s’agit des transferts Mostaganem –Arzew- Oran (MAO)
et El Harrach- Douéra, du transfert Béni-Haroun avec le passage
des eaux de la station de pompage de Aïn Kercha vers le
barrage de Koudiet M’daouar (W. Oum El Bouaghi – Batna), et de la
dérivation de Oued-Djer : elle permettra de transférer 25 hm3/an sur un
tunnel de 3 kms vers le barrage de Bouroumi en exploitation pour
l’irrigation de 24.000 ha de la Mitidja-Ouest.
Prévisions de livraison pour 2014 concernant les projets de barrages
de Tagharist (W. Khenchela, de Kef Eddir (W. Tipasa), de Taht et son
transfert (W. Mascara), de Beni Slimane (W. Médéa), d’Ouledjet Mellegue
(W. Tébessa), et les projets de transferts d’Oued Athmania –Ain
Kercha (W. Batna - Khenchela), d’Ain Kercha vers le barrage Ourkis
(W. Oum El Bouaghi), du barrage Boussiaba vers le barrage de Béni
Haroun (W. Jijel- Mila), de la station de pompage de Aïn Kercha vers le
barrage Koudiet Medouar (W. Batna-Mila), d’Ighil Emda- Mahouane (W.
Sétif), de Tabellout vers Draa Diss (W. Sétif), d’eau potable des
centres de Rouina, El Maine, Zeddine, El Attaf et Bourached à partir du
barrage de Ouled Mellouk (W. Ain Defla) et de l’alimentation en
eau potable à partir du barrage d’Oued Athmania de Chelghoum El Aïd,
Tadjenant et Constantine.
IV : Modernisation des infrastructures de base
1-Les infrastructures de transport
a- Transport terrestre :
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma National
d'Aménagement du Territoire (SNAT) à l'horizon 2025, la priorité a été
donnée au transport ferroviaire en tant que vecteur de développement, de
croissance et de modernité. U
L’enveloppe est d’environ 2 139 milliards DA (30
milliards de dollars environ), tous modes de transports confondus.
L’évolution du réseau ferroviaire est significative, qui est passée de 1 769 kilomètres en 2000 à 3 800 kilomètres en 2013. Pour l’année 2014, il est prévu d’atteindre 4 286 kilomètres de voie ferrée.
Le secteur a enregistré la mise en service de nouveaux
modes de transport urbain de voyageurs tels que le métro d’Alger dont la
1re ligne a été mise en exploitation en novembre 2011, les
tramways d’Alger, Oran et Constantine, les télécabines, les
téléphériques.
Cette même période a connu la création de nouvelles
entreprises publiques des transports urbains au niveau de toutes les
wilayas du pays.
Le programme de développement a retenu :
1- l’amélioration
du transport des voyageurs dans les localités et dans les grandes
agglomérations par la mise en service d’autorails et de trains rapides.
2- la poursuite
des extensions de tramway à Alger, Oran, et Constantine. La réalisation
des tramways au niveau des villes de Sétif, Annaba, Sidi Bel-Abbès,
Ouargla, Batna et Mostaganem.
3- la réalisation de 1 541 kilomètres de nouvelles voies et la modernisation de près de 1 200 kilomètres de voies existantes.
4- le dédoublement
des voies de la rocade Nord, la signalisation et l'électrification de
la rocade Nord, l'achèvement des études préalables aux travaux de
réalisation de la rocade des Hauts-Plateaux et de la Boucle du Sud.
Un budget de 2 816 milliards de DA a été dévolu, durant le dernier quinquennat, à la réalisation de 17 lignes ferroviaires (6 000 km) soit une évolution de 330% sur les précédentes réalisations, le parachèvement de l’électrification de la rocade ferroviaire Nord, le dédoublement de 800 kilomètres de voie.
Le lancement du métro d’Oran ainsi que la réalisation des extensions du
Métro d’Alger. Il est également prévu la réalisation de tramways dans 14 localités,
la mise en service en juillet 2014 de l’extension du Tramway
d’Alger-Est. Ce même secteur enregistre la réalisation de nouvelles
gares routières au niveau de tout le territoire national.
Le Téléphérique a également fait l’objet d’une
rénovation en 2009. Il s’agit de ceux de Mémorial-El Madania, Notre Dame
d’Afrique, Blida et celui du Palais de la Culture. En outre, il est
fait état de la réalisation de nouvelles télécabines à Tlemcen et
Skikda. En avril 2014, la télécabine entre Oued-Koriche et Bouzaréah,
soit 2,9 km, 3 stations, 17 pylônes et 58 cabines sera mise en service. Par ailleurs, 62 gares routières sont opérationnelles, en plus des 20 qui sont en cours de réalisation pour 2014.
En treize ans, pas moins de 2 150 km de
nouvelles lignes ferroviaires ont été ouvertes à la circulation. Parmi
les grandes réalisations de ces dernières années, figure en bonne place
la modernisation et la réouverture de la ligne reliant Oran à Béchar sur
une distance de 700 km. Il y a eu également l’électrification des lignes de la banlieue algéroise sur plus de 170 km en y incluant les faisceaux de gare, soit un total de 356 km.
D’autres nouvelles lignes de chemin de fer ont aussi été réceptionnées à
l’exemple de celles reliant M’sila à Aïn Touta,
Bordj-Bou-Arréridj-M’sila, Aïn M’lila Tébessa.
D’importants projets sont actuellement en phase de réalisation. Le
plus important reste le dédoublement et l’électrification de la ligne
ferroviaire reliant Oran à Annaba d’une longueur dépassant les 1 200 km. La
ligne passera par la capitale. Parmi d’autres projets figurent la
réalisation d’une nouvelle ligne électrifiée reliant Thénia dans la
Wilaya de Boumerdès à la ville de Tizi-Ouzou, la réalisation des travaux
de la ligne de chemin de fer des Hauts-Plateaux entre Saïda et Tébessa
sur une distance de 1 000 kilomètres.
Un autre projet d’envergure est en phase de réalisation, il s’agit de la
ligne reliant la Chiffa, dans la Wilaya de Blida, à la ville de
Laghouat sur une distance avoisinant les 400 km. Il est
question, entre autres, de la construction d’une nouvelle ligne de
chemin de fer électrifiée entre Annaba et Tébessa sur une distance de 420 km.
Cette ligne sera dédiée au transport des minerais de fer et de
phosphate à partir de la Wilaya de Tébessa. L’ensemble de ces projets
mobilisera une enveloppe financière de l’ordre de 32 milliards de
dollars. D’ici à 2018, le réseau ferroviaire aura une longueur de 10 000 km. Soit le réseau le plus important en Afrique après celui de l’Afrique du Sud.
b- Maritime : Douze ports commerciaux ont fait
l’objet de dragage et d’entretien, alors que 20 opérations de
réhabilitation portuaire seront poursuivies. Le pavillon national de
transport maritime de marchandises sera relancé dans le cadre d’une
association avec un partenaire étranger d’excellence.
c- Aérien : Sur les 25 projets de réalisation et de modernisation d’infrastructures aéroportuaires, 10 ont été livrés, à savoir, en 2009, 8
aérogares, ainsi que d’autres chantiers pour des extensions
d’infrastructures de passagers, et 2 portant sur le renforcement de la
flotte de la compagnie nationale Air Algérie.
L’Algérie a développé son secteur du transport aérien de
manière à en faire un véritable moyen d’intégration aux niveaux
régional et international. Une enveloppe de 60 milliards de dinars (600
millions d’euros) a été consacrée au renouvellement de la flotte d’Air
Algérie durant la période 2013-2017. La compagnie aérienne nationale se
dotera prochainement de trois nouveaux appareils d’une capacité de 150
sièges et renouvellera ses trois Boeing 767 actuellement en service. Il
est également question de l’acquisition de deux avions-cargos pour le
transport de marchandises.
2- Les Travaux publics
Le secteur des travaux publics remplit aujourd’hui des fonctions
stratégiques dans la relance de l’économie et la promotion de
l’investissement créateur de richesse et d’emploi, et qui suscite un
effet d’entraînement sur d’autres domaines.
En matière d’infrastructures routières et autoroutières, près de 9.000 kilomètres de nouvelles voies ont été réalisées entre 2004 et 2008, alors que la 2e rocade d’Alger sera livrée au courant du premier semestre 2009. De plus, 1 000 kilomètres de routes nationales et 132 kilomètres d’autoroutes ont été achevés.
Plus de 3 132 milliards de DA lui ont été consacrés en vue de finaliser l’autoroute Est-Ouest et de la compléter par 830 kilomètres de liaisons autoroutières. Il s’agit également de réaliser 2 500 kilomètres de routes nouvelles, de moderniser et réhabiliter plus de 8 000 kilomètres de route et 20 ports de pêche. Le dragage et le confortement de 25 ports ainsi que le renforcement de 3 aérodromes ont été au programme de ce quinquennat.
Les infrastructures routières et autoroutières représentaient en 2000, 104 325 kilomètres, en 2013 quelque 116 962 kilomètres, atteignant en 2014 un total de 117 498 kilomètres. Ce réseau routier représentait en 2013, 30 828 kilomètres de routes nationales, 24 505 kilomètres de chemins de wilaya, 60 733 kilomètres de chemins communaux et 1 096 kilomètres d’autoroutes et de voies express.
Plusieurs autres projets d’autoroutes et d’ouvrages d’art ont été lancés. On en dénombre 40, ils portent sur le développement du réseau routier sur une distance de 2 000 km, d’un coût financier de l’ordre de 76 milliards de dinars. Il est également question de la réalisation de 16 projets d’ouvrages d’arts et de tunnels d’un montant de 24 milliards de dinars et de 12 autres projets routiers totalisant une longueur de 230 km.
Le lancement prochain des travaux de ces nouveaux projets vient
s’ajouter aux récents chantiers de réalisation des pénétrantes
autoroutières entre Beni-Mansour et Béjaïa, Jijel et Sétif, Bouira et
Tizi-Ouzou et la Chiffa et Berrouaghia.
3-Aménagement du territoire
La question environnementale a été au cœur des
préoccupations de l’Etat durant ce quinquennat avec la création, en
2000, d’un ministère spécialement dédié à la question. Il a été doté d’une enveloppe de près de 500 milliards de DA pour la réalisation de 4 villes
nouvelles et diverses opérations de préservation de l’environnement, y
compris la gestion des déchets. Le ministère de l’Aménagement du
territoire et de l’Environnement a adopté une stratégie et un plan
d’action pour le développement durable et le programme intégré de
gestion des déchets ménagers et assimilés. Parmi les réalisations phares
de ce quinquennat, le centre d’enfouissement technique (CET) de Hamici
(Mahelma). Opérationnel depuis septembre 2013. L’importance de ce centre
réside dans son respect des normes en vigueur en matière de traitement,
de tri et d’enfouissement des déchets ménagers.
L’Algérie a été, à ce dernier titre, désignée par ces
pairs africains comme porte-voix du continent africain à la Conférence
internationale sur le climat prévue à Paris (France) en 2015.
Durant la période 2009-2013, les principales actions menées ont concerné la réalisation des études d’urbanisme, dont 781 études de plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme (PDAU), 917 études de plans d’occupation des sols (POS), ainsi que 289 études
spécifiques (études géotechniques, de micro-zonage, aléas, etc.). En
matière d’aménagement urbain, une enveloppe financière globale d’un
montant de 167,8 milliards de DA a été inscrite et a
permis la prise en charge des opérations d’amélioration urbaines, de VRD
primaires et secondaires et de VRD tertiaires pour l’habitat rural
groupé. Pour l’année 2014, on prévoit, en matière d’études d’urbanisme, 160 études de plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme (PDAU), 300 études de plans d’occupation des sols (POS) et 175
études spécifiques (études géotechniques, de micro-zonage, aléas…).
Pour ce qui est de l’aménagement urbain, il est prévu l’inscription
d’une enveloppe financière d’un montant de 105,7 milliards de DA, dont 33,5 milliards de DA pour les opérations d’amélioration urbaine, 48,1 milliards de DA pour les opérations de VRD primaires et secondaires et 24,05 milliards de DA pour les opérations de VRD tertiaires destinés à l’habitat rural groupé.
V- Aux plans économique et social
«C’est dans une perspective de préservation et de
promotion du pouvoir d’achat des travailleurs que l’abrogation de
l’article 87-Bis de la loi relative aux relations de travail a été
abordée dans un cadre de concertation avec les partenaires sociaux en
vue de sa stipulation dans la loi de finances pour l’année 2015. Cette
nouvelle approche doit permettre de consolider un salaire minimum
garanti et le rattrapage des revenus des travailleurs de basses
catégories professionnelles, mais aussi de donner aux entreprises
davantage de flexibilité pour mieux rétribuer les rendements des
travailleurs.» Message du Président Bouteflika à l’occasion
de la célébration, ce 24 février 2014, de l’anniversaire de la création
de l’UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures.
Le développement économique a connu des progrès notables
grâce au programme d’investissement exceptionnel lancé lors du dernier
quinquennat et l’apport financier conséquent de l’ordre de 1 566 milliards de DA.
Le maintien d’un rythme de croissance économique ascendant, le taux de
croissance général hors hydrocarbures et le fléchissement constant de la
courbe du chômage qui a atteint 9,8% à la fin de l’année 2013 contre 29,8% en 2000, sont les témoins de ces résultats.
- 1. Nette amélioration des équilibres généraux de l'économie nationale avec
- une inflation qui passe de 5% en 1998 à 3,5% en 2007 et 2009 pour atteindre 3,3% fin 2013
- des réserves de change largement reconstituées,
passant de 4,4 milliards de dollars en 1999, à 140 milliards de dollars
en 2008. A fin 1013, les réserves de change sont de 194 milliards de
dollars, soit une évolution de 1 530% de 2000 à 2013
- un endettement extérieur du pays qui a été ramené
de plus de 25,11 milliards de dollars en 1999, à moins de 5 milliards de
dollars actuellement, soit une réduction de la dette de 86%
- une croissance moyenne hors hydrocarbures qui s’est stabilisée, sur les dix dernières années, autour de 5%. Elle
est passée de 1,2% en 2000, a culminé à 9% en 2009 avant d’amorcer une
baisse et atteindre les 6,4% en 2013. On évalue à 5,64% la moyenne de la
croissance du PIB hors hydrocarbures durant la période 2000-2013
- un programme complémentaire de soutien à la
croissance (PCSC) et des programmes Sud et Hauts-Plateaux lancés entre
2005 et 2009 sur un financement budgétaire totalisant plus de 200
milliards de dollars, le lancement de deux programmes pluriannuels de soutien à l’économie
- des dépenses d'équipement public qui se confortent d’une épargne de l'Etat de plus de 4 000 milliards de dinars dans
le Fonds de régulation des recettes, et d’une dette publique intérieure
ramenée de près de 1 800 milliards de dinars à près de 700 milliards de
dinars aujourd’hui, et des exportations en hydrocarbures dont la moyenne annuelle est passée de 72 millions
de Taux d’équivalent pétrole (TEP) durant la période 1971-1999 à plus
de 132 millions de TEP entre 2000 et 2007, soit 34 milliards de
dollars/an entre 2000 et 2007 contre 9 milliards de dollars/an entre 1971 et 1999
- un PIB qui a connu une augmentation significative
durant ces dix dernières années en passant de 4 123 milliards de DA en
2000 à 17 521 milliards de DA fin 2013. Soit une évolution de 324%
- un PIB hors hydrocarbures qui a également
enregistré une hausse allant de 2 507 milliards de DA en 2000 à 12 122
milliards de DA fin 2013. Soit une évolution de 383%
- une croissance de PIB qui
est passée de 2,2% en 2000, et qui a culminé à 6,9% en 2003,
enregistrant une baisse depuis pour atteindre 3% en 2013. Le taux moyen
de la croissance du PIB durant la période 2000-2013 est estimé à 3,5%
- un PIB par habitant qui a connu une avancée notable, passant de 1 801 dollars US en 2000 à 5 764 dollars US fin 2013. Soit une évolution de 220%
- un Revenu national brut par habitant qui a suivi la même tendance haussière, passant de 1 458 dollars US en 2000, à 6 050 dollars US fin 2013. Soit une évolution de 276%
- des exportations des hydrocarbures, durant la période 2000-2013, qui sont passées de 21,1 milliards de dollars à 63,5 milliards de dollars. Soit une augmentation de 200%
- des importations des marchandises, ces dix dernières années, qui sont passées de 9,2 milliards de dollars à 54,9 milliards de dollars. Soit une augmentation de 496%
- des dépenses d’équipements publics qui sont passées de 318 milliards de DA en 2000 à 1 690 milliards de DA à fin 2013. Soit une augmentation de 330%. Parallèlement, les dépenses de fonctionnement qui représentaient 881 milliards de DA en 2000 ont atteint les 4 224 milliards de DA à fin 2013. Soit une augmentation de 379%
- un taux de la masse salariale par rapport au budget de fonctionnement, qui représentait 57% en 2000 contre 62,7%
à fin 2013. Une augmentation générée par l’amélioration successive des
salaires des travailleurs et le recrutement dans le secteur public
- un relèvement du montant du SNMG de 6 000 DA en 1999 à 10 000DA en 2005, puis à 18 000 DA en 2012, soit une augmentation de 134% entre 1999 et 2012
- un relèvement des salaires des fonctionnaires et agents publics lié à la mise en œuvre des statuts particuliers et régimes indemnitaires, induisant des gains allant de 64% à 171%
- une révision des conventions et accords de branches pour le secteur économique qui a induit des augmentations de salaires de 10 à 20% pour le secteur privé et de 22% en moyenne pour le secteur public
- des transferts sociaux sur le PIB qui ont également connu une hausse en passant de 6,4% dans les années 2000 à 8,4% fin 2013.
- Relèvement des salaires des fonctionnaires et agents publics lié à la mise en œuvre des statuts particuliers et régimes indemnitaires induisant des gains allant de 64% à 171%.
- Révision des conventions et accords de branches pour le secteur économique induisant des augmentations de salaires de 10 à 20% pour le secteur privé et de 22% en moyenne pour le secteur public.
- La Part des transferts sociaux sur le PIB a connu une hausse en passant de 6,4% dans les années 2000 à 8,4% fin 2013.
- Les revenus des ménages et des entreprises individuelles sont
passés de 2 022,1milliards de DA en 1999 à 9 966,5 milliards
de dinars à la fin 2012, soit une progression de 492%.
- La consommation des ménages est passée de
2 908,9 milliards de DA en 2007 à 5 125,5 milliards de dinars
en 2012 soit une augmentation de 176,2% en l’espace de 5 années.
- L’épargne des ménages est passée de 1 275,5 milliards de dinars en 2007 à 2 949,6 milliards de DA en 2012 soit une progression de 231,11%.
2- Relance des secteurs porteurs de croissance
Plusieurs secteurs ont constitué des points d’appui
essentiels au retour de la croissance, à la densification des activités
productives, renforcés par une aide conséquente de l’Etat puisque les
crédits à l’économie sont passés de 993 milliards de DA en 2000 à 5 154 milliards de DA fin 2013. Soit une évolution de 418%.
Le secteur privé a bénéficié d’un soutien financier de l’ordre de 2 432 milliards de DA fin 2013 contre 291 milliards de DA en 2000. Soit une évolution de 734%.
De son côté, le secteur public s’est vu alloué un crédit de l’ordre de 2 721 milliards de DA fin 2013 contre 701 milliards de DA en 2000. Soit une évolution de 287%.
- Les PME : La PME a été fortement encouragée et soutenue à la fois par les pouvoirs publics en lui accordant une enveloppe de près de 100 milliards de DA, dont 16 milliards de DA destinés à l’accompagnement de la création des PME et 80 milliards de DA dédiés à l’appui de la mise à niveau de 20 000 PME
sous forme d’aides directes ou de bonifications de crédits bancaires.
Les crédits bancaires ainsi bonifiés pourront atteindre, quant à eux, 300 milliards.
- Modernisation des entreprises publiques détentrices de parts de marché localement. Dans cette perspective, près de 400 milliards de DA
leur ont été octroyés à travers des interventions du Trésor sous forme
d’assainissement et de bonification des intérêts des crédits bancaires
destinés à leur modernisation.
- Modernisation et réalisation de 80 zones industrielles et d’activités. Lors de ce dernier quinquennat, près de 50 milliards de DA ont été investis à cet effet.
- Bâtiment : la relance de ce secteur,
au cours de cette période a permis d'élargir, de façon substantielle,
le parc immobilier du pays (près de 3 millions de logements entre
2000-2013), d'améliorer la qualité du cadre bâti et de réduire les coûts
et les délais de réalisation des infrastructures.
Il faut relever à cet égard :
- la mise en œuvre des mesures d’encouragement fiscales au profit des
entrepreneurs, l’application effective de la garantie de l’Etat
désormais accordée aux crédits couverts par la caisse de garantie pour
les PME
- l’accroissement du soutien à la mise à niveau des entreprises
- le renforcement de l’appui à la promotion de l’innovation au sein de la PME
3-Investissement et promotion de l’emploi
Une véritable bataille contre le chômage a été engagée. Une enveloppe de 360 milliards de DA a été accordée à ce volet, dont 150 milliards de DA
destinés à l’appui et à l’insertion des diplômés de l’enseignement
supérieur et de la formation professionnelle dans le cadre des
programmes de formation et de qualification. 80 milliards de DA
ont été destinés en soutien à la création de micro-entreprise et de
micro-activités. D’autres mesures visent à la promotion de l’emploi,
notamment la réduction de l’apport personnel au titre du financement de
l’investissement qui a été ramené de 5% à 1% pour les investissements ne dépassant pas 5 millions de DA et de 10% à 2% pour les investissements allant jusqu’à 10
millions de DA. Il y a également l’extension des périodes de différé à
une année sur le remboursement des intérêts et à trois années sur le
paiement du principal crédit bancaire. Comme il est prévu la réservation
d’un quota de 20% de contrats publics locaux aux micros entreprises en application des dispositions de l’article 55ter du code des marchés publics, ainsi que l’octroi d’un crédit supplémentaire et sans intérêt de 1
million de DA pour la location d’un local destiné à servir de cabinet
médical, d’architecte, d’avocat ou autre pour un minimum de 2
diplômés universitaires. Des mesures de facilitation fiscales sont
prévues pour les micros entreprises implantées dans le Sud, puisque
elles bénéficient d’un allongement de la période de l’exonération de
l’impôt sur le revenu global, de l’IBS, de la TAP et de la taxe foncière
à 10 ans à compter de leur mise en exploitation. L’encouragement de la
création d’activités par les jeunes et les chômeurs promoteurs est
également encouragé par la fixation, à deux mois, du délai de traitement
des dossiers de demande de crédits d’investissement par les banques, la
décentralisation du pouvoir de décision des agences et des banques, la
bonification depuis juillet 2013 à 100% des taux
d’intérêt sur les crédits bancaires accordés aux jeunes promoteurs et
aux chômeurs promoteurs dans le cadre des dispositifs ANSEJ et
CNAC.
Les 130 milliards de DA restants ont été
consacrés aux dispositifs d’emploi d’attente. Ce financement, renforcé
par la mise en place de dispositifs d’insertion professionnelle, a
permis une baisse notoire du taux de chômage en passant de 29,8% en 2000 à 9,8% en 2013, soit une évolution de -66% durant ces 15 dernières années.
Les objectifs assignés par les pouvoirs publics durant la période 2010-2014 est la création de 3 millions d’emplois, soit 60 000 par an dont 1,5 million créés dans le cadre des investissements et 1,5 million
dans la cadre des dispositifs d’attente. Parmi les dispositifs publics
de promotion d’emplois, on note que le dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP) bénéficiait d’un budget de 445, 5 milliards de DA pour la création de 1.592.535 contrats d’insertion, les prévisions de 2014 tablent sur la création de 222 000 contrats d’insertion, et ce, en s’appuyant sur un budget de 143,3 milliards de DA.
L’ANEM a placé 1.007.234 chômeurs et table sur 300 000 autres placements en 2014. De son côté, la CNAC a financé 86 389 projets durant la période 2009-2013 pour un potentiel de 162.242 emplois. Il est prévu en 2014, un financement de 25 000 projets pour 47 500 emplois.
L’ANSEJ a, pour sa part, financé 159.172 projets durant la période 2009-2013 pour un potentiel de 436.062 emplois. Pour l’année 2014, il est prévu que 70 000 projets soient financés pour un potentiel de 189 000 emplois.
TOURISME
L’Algérie recèle de grandes potentialités naturelles et culturelles à
développer. Le tourisme est un secteur clé, stratégique et
pourvoyeur d’emplois qui peut permettre une diversification de
l’économie. Il est également un moteur de développement durable et de
soutien à la croissance. C’est dans cette optique que les pouvoirs
publics ont encouragé la promotion de la destination Algérie via
l’investissement, notamment hôtelier, dans la capitale et les grandes
villes afin d’assurer de plus grandes capacités, en matière d’accueil et
d’hébergement, aux touristes.
Ainsi, 3 établissements réalisés au cours de la période 2009-2013,
doivent être réceptionné en 2014. Il s’agit de l’Hôtel Four-Point à
Oran, l’Hôtel Marriott à Constantine et le Sheraton à Annaba. Un centre
de formation, à savoir l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de
restauration à Aïn-Bénian (Alger) est également attendu pour l’année
2014. D’autres établissements sont fonctionnels et ont permis
d’accroître les capacités d’accueil du pays. Il s’agit des hôtels
Méridien et Sheraton à Oran, d’une tour d'affaires/Appart-Hôtels ainsi
que l’Hôtel «Renaissance Marriott» à Tlemcen. Au total, ce sont près de 7
établissements qui ont été réceptionnés.
Un autre défi est à relever. Il s’agit d'insérer le tourisme national
dans les circuits commerciaux du tourisme mondial et ce, grâce à la
promotion de la destination Algérie au statut de destination touristique
de référence au plan international. C’est ainsi que le gouvernement a
décidé de se doter d'un cadre stratégique de référence et d'une vision à
l'horizon 2025, adossés à des objectifs contenus dans le schéma
d'aménagement touristique, «SDAT». Ce dernier est une composante du SNAT
(Schéma national d'aménagement du territoire) 2025, prévu par la loi
02-01 du 12 Décembre 2001 relative à l'aménagement du territoire et du
développement durable.
VI – Développement humain
Le rythme de la construction d’écoles, de centres de formation
professionnelle et d’universités sera maintenu, tout comme la poursuite
de la mise en application de la réforme et de la modernisation du
système national d’enseignement ainsi que la promotion de la recherche
scientifique.
Un effort important sera également fourni dans le domaine de la santé
publique par l’ouverture de nouveaux hôpitaux et autres
infrastructures, de même que le parachèvement de la réforme, pour plus
de transparence, mais toujours au service des citoyens.
1 – Education Nationale :
Objectif : poursuivre les réformes dans un secteur qui a
accueilli à la dernière rentrée scolaire un total de plus de 8 millions
d’élèves, avec un taux de scolarisation des enfants de 6 à 15 ans
atteignant 97% pour les garçons et 95% pour les filles. Un intérêt
particulier a été accordé au secteur de l’Education nationale en le
dotant d’une enveloppe budgétaire de 852,095 milliards de DA, en
vue de la réalisation de plus de 3 100 écoles primaires, 1 100
collèges, 840 lycées ainsi que plus de 2 000 internats, cantines et
demi-pensions.
De 2000 à 2014, il a été réalisé 944 nouveaux lycées,
1.885 nouveaux collèges et 2.324 écoles primaires. En outre, des
programmes d’amélioration qualitative ont été menés.
2- Enseignement Supérieur
Il s’agit de parachever la mutation de l’université dont le nombre de
diplômés est passé de 52.804 en 2000 à 285.000 en 2013 et se préparer à
accueillir 2 millions d’étudiants en 2015 dans les universités et les
nouvelles écoles nationales supérieures dans certaines filières.
L’amélioration des conditions de vie des étudiants s’est concrétisée
notamment, par la dernière décision du président de la République
d’augmenter de 50% la bourse universitaire depuis l’année 2009. Les
étudiants inscrits en post-graduation sont, quant à eux, estimés à 70 400 en 2013 contre 22.533 en 2000. Les diplômés de ce rang ont largement augmenté, passant de 2 169 en 2000 à 10 800 en 2013. Concernant l’encadrement, le corps enseignant a enregistré une nette augmentation allant de 17 460 en 2000 à 50 100 en 2013. Ce nombre est appelé à croître en 2014 pour atteindre la barre des 55 000.
Le budget de 768 milliards DA, alloué au secteur sur la période 2010-2014, est dédié à la réalisation de 600 000 places pédagogiques, 400 000 places d’hébergement et 44 restaurants universitaires.
Le secteur dispose aujourd’hui de 92 établissements
universitaires qui couvrent l’ensemble du territoire national. Illizi,
cette wilaya isolée du Grand-Sud, a eu également droit à une université.
Concernant les réalisations érigées durant la période 2009-2014, on
comptabilise 312 150 places pédagogiques, 161 600 lits d’hébergement, 21 bibliothèques centrales et 20 restaurants centraux. Pour l’année 2014, il est attendu la livraison de 75 100 places pédagogiques, 67 950 lits d’hébergement, 4 bibliothèques centrales et 2 restaurants centraux.
3- Recherche Scientifique :
Objectif : développer la recherche en liant ses objectifs aux besoins
du développement du pays (34 programmes nationaux, 6.244 projets dont
plus de 200 finalisés, 7.031 publications, 14.510 communications
nationales et internationales, 4.111 thèses de doctorat soutenues,
23.588 magistères soutenus et 15 brevets déposés).
-
34 milliards DA sur les crédits ont été consacrés à ce secteur et 100
milliards de DA sont alloués sur cinq ans depuis 2008.
- Les étudiants en doctorat, qui n'ont pas de salaire, ont bénéficié,
dès 2009 d’une bourse de 12.000 DA par mois pour encourager le
renforcement des rangs des personnels enseignants des universités ainsi
que la promotion de la recherche scientifique.
50 milliards de DA sont destinés à acquérir des
équipements destinés à la généralisation de l’enseignement de
l’informatique dans tout le système national d’éducation, d’enseignement
et de formation.
4- Formation Professionnelle
Destiné à accorder une chance aux exclus du système scolaire en les
aidant à acquérir une formation tout en dotant le marché de l’emploi
d’une main-d’œuvre qualifiée, le secteur de l’enseignement et la
formation professionnelle a bénéficié d’une enveloppe budgétaire de près
de 178 milliards de DA destinée, notamment, à la réalisation de 220 instituts, 82 centres de formation et 58 internats. En 2013, on a comptabilisé 92 instituts de formation professionnelle et 734 centres de formation professionnelle (CFPA). Pour l’année 2014, le secteur comptabilisera au total 766 CFPA et 101
instituts. Par ailleurs, il a été décidé la révision du niveau d’accès à
la formation professionnelle dans certaines spécialités et de le
ramener à un niveau inférieur à la 4e année moyenne, dans
certaines spécialités, telles que l’apiculture, l’élevage de petits
animaux, coiffure hommes et blanchisserie pressing. Cette révision porte
également sur l’intégration de la spécialité «installation sanitaire»
dans les métiers de la plomberie. Les nouvelles mesures concernent aussi
l’augmentation de l’offre de formation par apprentissage en référence à
l’instruction du 17 novembre 2013 portant mesures visant à redynamiser
l’apprentissage.
5- Santé et sécurité sociale
A/ Santé : Un effort important a
été consenti dans le domaine de la santé publique par l’ouverture de
nouvelles structures de proximité et le lancement de la construction de
nouveaux CHU, notamment dans le Sud et les Hauts-Plateaux et ce, pour le
bien-être du citoyen.
Le domaine de la santé reste un secteur clé dans l’amélioration de la
vie des citoyens. Pour cela, la construction d’infrastructures tel que
déterminé par la carte sanitaire est prise en charge par l’Etat. A ce
titre, 619 milliards de DA ont été alloués au secteur de la santé pour la période 2010-2014 et sont dévolues à la réalisation de 173 hôpitaux, 45 complexes spécialisés de santé, 377 polycliniques, 1 000 salles de soins et 17 écoles de formation paramédicale. Le nombre d’hôpitaux qui était en 2000 de 230, a atteint en 2013 les 291. Le nombre des polycliniques, quant à lui, a considérablement augmenté, passant de 497 en 2000 à 1 588 en 2013. Les prévisions pour 2014 tablent sur un total de 1 616
polycliniques. Afin de lutter contre les déserts médicaux, la formation
du personnel médical s’est accrue, réduisant ainsi le nombre
d’habitants pour un médecin. En 2000, il y avait un médecin généraliste
pour 1 746 habitants. En 2013, il y a un médecin pour 1 295 habitants. S’agissant des médecins spécialistes, en 2000, le taux était de 1 spécialiste pour 2 834 habitants. En 2013, il est de 1 pour 1 806. Pour la catégorie des dentistes, en l’an 2000, on comptabilisait 1 dentiste pour 9 122 habitants, en 2013, le taux est de 1 dentiste pour 3 128 habitants.
Face à ces efforts, des défis perdurent, notamment celui de la lutte
contre la mortalité infantile, en dépit de sa très forte baisse, passant
de 36,9% pour 1 000 habitants en 2000, à 26,1% en 2013. L’autre défi réside en la baisse du taux de mortalité maternelle, puisqu’il est passé de 96,5% pour 100 000 habitants en 2005, à 70,3% en 2013. Pour ce qui est du taux brut de mortalité pour 1 000 habitants, il est passé de 4,59% en 2000 à 4,53% en 2013.
Le renforcement du corps médical a permis d’assurer une couverture
médicale proche des normes dans les pays développés. L’espérance de vie a
fortement augmenté, passant de 71,5 ans en 2000 à 76,4 ans en 2013. La croissance démographique connaît la même tendance haussière, passant de 1,48% en 2000 à 2,16% en 2013. En outre, il est à souligner que L’Etat a consenti une subvention non négligeable pour le secteur qui s’élève à 263,7 milliards de DA fin 2013 contre 33 milliards en 2000.
Dans le souci de répondre aux besoins de la santé publique et de
juguler la pénurie de médicaments, cette dernière décennie a enregistré
la création de 55 unités pour la fabrication locale de médicaments
génériques.
Pour lutter contre le manque de spécialistes dans les hôpitaux du
Sud, il a été procédé au jumelage entre les CHU du Nord et ceux des
Hauts-Plateaux et des hôpitaux du Sud. Ces conventions visent à dépêcher
des missions médicales et paramédicales du CHU de Beni Messous aux
hôpitaux des wilayas du sud (Ouargla, Adrar et Illizi) pour prendre en
charge les différentes spécialités souffrant de déficit. Par ailleurs,
il a été décidé la réalisation de trois CHU à Béchar, Laghouat et
Ouargla en vue de renforcer la couverture sanitaire dans ces
régions.
e/Volet sécurité sociale :
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité des prestations, des
structures de proximité des caisses de sécurité sociale ont été
développées. Leur nombre est passé de 1 100 en 2009 à 1 500
en 2013. Par ailleurs, le système du tiers payant pour les soins de
santé s’est généralisé pour le médicament depuis 2011 auprès de 10 198 pharmacies conventionnées. Près de 30 millions
de bénéficiaires en 2013 (assurés sociaux et leurs ayants droits) sont
comptabilisés. Plusieurs structures sanitaires sont conventionnées pour
assurer une meilleure couverture des soins. Il s’agit notamment de 130 centres d’hémodialyse privés conventionnés au profit de 7 360 malades, 13 cliniques de chirurgie cardiaque pour la prise en charge de 7 200 patients et 320 opticiens conventionnés. Pour ce qui est du transport sanitaire, 264 entreprises sont conventionnées. Le dispositif de médecins traitants comptabilise 2 760 praticiens.
Par souci d’améliorer l’accessibilité aux soins des assurés sociaux
et contribuer au dépistage précoce de maladies lourdes telles que le
cancer du sein, 32 526 patients ont bénéficié d’examens à titre gracieux au niveau des centres régionaux d’imagerie médicale.
Modernisation de la sécurité sociale :
Dans le cadre de la modernisation de ce volet, le développement du
système de la carte électronique de l’assuré social «chiffa» est établi
dès 2009. Le nombre des bénéficiaires est passé de 2.284.177 cartes, soit 7.583.468 bénéficiaires à 9.018.951 cartes, soit 29.942.917 bénéficiaires en 2013.
Revalorisation des retraites :
En vue de l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités, l’Etat a revalorisé les petites pensions de retraites de 5% en 2009 et de l’ensemble des retraites de 15 à 30% en 2012, assorti de l’augmentation de la pension minimum à 15 000 DA. La revalorisation annuelle des pensions et allocations des retraites durant la période 2009-2013 est de l’ordre de 42%.
VII- Satisfaction des besoins sociaux de base de la population
La période allant de 1999 à 2014 a connu un nombre considérable de
réalisations, notamment dans les domaines de l’habitat, de l’extension
des réseaux de distribution du gaz, de l’électricité et de l’eau
potable.
a- Logement : le secteur a
connu la livraison de près de 2,7 millions de logements. Dans le
domaine de l’habitat, le Président Abdelaziz Bouteflika s’est attelé à
insuffler une dynamique avec le lancement et la réalisation de logements
sous différentes formules pour renforcer le parc immobilier. Ces
réalisations ont amélioré les conditions de vie des citoyens. Le taux
d’occupation par logement est de 4,65% en 2013 et ce, sur la base
de l’évolution du parc de logements qui est passé de 5.416.331 unités en
2000 à 8.040.932 en 2013, soit plus de 2.600 000 logements de plus. En
outre, un soutien financier de 203,5 milliards de DA a été attribué au
secteur en 2013 par rapport aux 67 milliards de DA en 2000.
Les régions du Sud et des Hauts-Plateaux ont également bénéficié de
ce programme. Pas moins de 93 000 logements ont été construits dans
les régions des Hauts-Plateaux durant cette période et 56 000
autres dans le Grand-Sud. En parallèle, l’Etat a mobilisé, durant la
même période, plus de 300 milliards de dinars pour financer des projets
d’amélioration urbaine, tandis que 448 milliards de DA ont été consacrés
aux études techniques et à la réduction du déficit enregistré en
matière d’infrastructures vitales au niveau des cités et des villes.
Depuis 2009, 1 000 sites ont bénéficié de ce plan.
Durant la période 2009-2013, le nombre total de logements réalisés
est de 950.981 unités. Ils sont répartis en 322.477 logements publics
locatifs (LPL), 137.574 logements sociaux participatifs (LSP), 18.448
logements location-vente (LV) et 472.482 logements ruraux. Les
prévisions retenues pour l’année 2014 sont arrêtées à 371.084 logements.
b- Eau potable :
Les réalisations du secteur ont permis d’accroître le taux national
de raccordement au réseau AEP en passant de 80% dans les années 2000 à
95% en 2013. Les prévisions tablent sur un raccordement de 98% pour
l’année 2014. Le taux de raccordement au réseau d’assainissement s’est
accru, passant de 72% dans les années 2000 à 88% en 2013. Un taux de 90%
est prévu pour l’année en cours.
Pour assurer également l’alimentation en eau potable des populations
vivant loin des ressources, un gigantesque transfert sur une
distance de 700 kms a été réalisé dans la wilaya de Tamanrasset. D’un
coût de deux milliards de dollars, ce transfert d’une capacité de
200 000 m3 par jour permet d’alimenter en eau la ville de
Tamanrasset à partir des nappes d’In Salah.
La stratégie de développement en matière de dotation de la population
en eau potable a permis d’accroître le nombre de litres/jour/habitant,
passant de 123 litres/jour/habitant en 2000, à 175 l/jour/habitant en
2013. Les prévisions de 2014 tablent sur une alimentation de 178
litres/jour/habitant.
Infrastructures d’alimentation en eau potable
AEP et adduction
Les projets d’adduction d’eau sont mis en œuvre de façon
systématique, soit avec les barrages en exploitation ou en réalisation,
soit avec les systèmes de transferts, soit avec les stations de
dessalement d’eau de mer. Seize grands projets d’adduction ont été
réalisés durant la période 2009-2013. Il est attendu la livraison en 2014 de :
- Rénovation du réseau de distribution de la nouvelle ville de Tamanrasset y compris comptage et raccordement (W. Tamanrasset).
- Adduction El Attaf à partir du barrage Ouled Mellouk :
Renforcement de l’AEP de Rouina, El Maine, Zeddine, El Attaf et
Bourached, population concernée 282 000 habitants ;
- AEP des communes El Adjiba, Ahnif, Chorfa, M’chedellah et Ath
Mansour à partir de la station de traitement de Tilesdit :
155 000 habitants ;
- Réalisation de l’adduction du barrage d’Ighil Emda vers Draa El
Gaid, lot : adduction secondaire vers Merdj Ouamen, Rahouine et
Dradra, population concernée 7 000 habitants.
- AEP du grand Blida à partir du système d’AEP des villes de Batna, Souk Ahras, Sidi Bel Abbes, Tamanrasset et Mascara.
d/Gaz et électricité
Ces dernières années ont connu un nombre considérable de
réalisations, notamment dans le domaine de l’extension des réseaux de
distribution du gaz et de l’électricité, permettant ainsi à la
population d’avoir accès à ces ressources sans augmentation des prix.
Plus de 350 milliards de DA ont été consacrés au secteur de
l’Energie. Il s’agit notamment, à la fin 2013, du raccordement de près
de 3.966.039 foyers au réseau gaz naturel et plus de 7.696.121 foyers au
réseau d’électricité. Les prévisions pour 2014 sont de 4.137.612 foyers
raccordés au gaz et 7.978.226 à l’électricité. Il est à souligner que
le nombre de foyers raccordés à ces ressources énergétiques a connu une
augmentation exponentielle, puisque l’on est passé d’un taux de
pénétration de gaz de 31% dans les années 2000 à 51% en 2013. Ce taux
devrait atteindre 53% en 2014. Concernant l’électricité, le taux de
raccordement a atteint près de 88,7% dans les années 2000 pour être
porté à 99% en 2013. Ce taux devrait s’élever à 99,4% en 2014. Par
ailleurs, afin de faciliter l’accès des populations au gaz, à
l’électricité et à l’eau, l’Etat a consenti une aide conséquente qui
s’élève à 66 milliards de DA fin 2013.
- Les programmes publics d’électrification et de distribution publique
gaz (ER et DP Gaz) s’insèrent dans le cadre de la politique de
développement durable du pays. Les programmes nationaux, régionaux ou
spéciaux sont soutenus financièrement par l’État. Ils traduisent
l’engagement des Pouvoirs publics en faveur du développement durable et
représentent un vecteur de développement socioéconomique du
pays. Les efforts de l’Etat en matière d’électrification et de
distribution publiques du gaz ont permis d’augmenter le nombre
d’utilisateurs des deux énergies et d’améliorer le niveau et la
qualité de vie des populations.
- En raison de la forte croissance de la demande sur l’énergie
électrique, le gouvernement a lancé, à partir de 2012, un plan d’urgence
visant à construire plusieurs nouvelles centrales électriques dotées
d’une puissance de 12 000 MW à l’horizon 2017. Il est également
question dans ce plan, de la réalisation de 13 000 km de lignes
haute tension et 150 000 km de lignes de distribution. Ces
nouvelles réalisations coûteront à l’Etat 27 milliards de dollars.
- Avec l’augmentation des capacités de production électrique et le
raccordement de nouveaux foyers au gaz naturel, la demande interne en
cette énergie propre pourrait avoisiner les 40 milliards de m3 à
l’horizon 2018.
Branche hydrocarbures :
Durant la période 2009-2013, le secteur a connu, en matière de transport par canalisation, la réalisation de 7 projets. Il s’agit de :
- Gazoduc GZ4 48 entre Hassi R Mel et Arzew d’une capacité de 11 milliards de m3/ an
- Oléoduc condensat LK1 30 entre Haoud El Hamra et Skikda d’une capacité de 11 millions de t/ an
- Looping du gazoduc GEM 48 d’une capacité de 5 milliards m3/an
- Oléoduc GPL LZ2 24 entre Hassi R Mel et Arzew d’une capacité de 6 millions de t/an
- Gazoduc medgaz 48 entre Beni Saf et Alméria de 8 milliards m3/ an
- Gazoduc GK3 48 entre Hassi R Mel- Skikda6 El Kala de 10 milliards m3/ an
- Gazoduc GR4 48 entre Rhoude Nouss -Hassi R Mel de 9 milliards m3/an
Pour 2014, il est prévu la réalisation de 2 projets, l’expansion de l’oléoduc GPL LR1 PHASE II entre Hassi Messaoud- Hassi RMel d’une capacité de 4, 5 millions de t /an ainsi que le remplacement GZ3 42 entre Nador et Kenanda.
7 projets ont été réalisés entre 2009 et 2013 et 1 projet est prévu pour 2014, il s’agit du Mega train GNL Arzew GL3Z d’une capacité de 4,7 millions t/an
- Projet de dessalement d’eau de mer
7 stations ont été mises en service
entre 2009 et 2013. Pour 2014, il est attendu la mise en service de la
station de Magtaâ à Oran.
Branche énergie :
De 2009 à 2013, il est fait état de la réalisation de 67 centrales électriques d’une capacité totale de 6 656 MW.
Pour l’année 2014, il est prévu la réalisation de 15 centrales électriques d’une capacité globale de 3 751 MW.
VIII- Développement du sport
Le secteur a bénéficié de nombreuses réalisations ces 15 dernières
années, et l’Etat s’est engagé à continuer à soutenir le sport en
améliorant son mode d’intervention.
- 44 stades omnisports, 249
complexes sportifs de proximité, plus de 850 terrains sportifs de
proximité, 187 piscines et bassins de natation, ainsi que plus de 70
salles omnisports entre 1999 et 2008.
- La relance de la pratique sportive et des compétitions scolaires et
universitaires, avec comme objectif d’encadrer 2 millions de licenciés
sur un horizon de cinq années.
- La réorganisation du système d’aide publique au
sport devant conduire à une intervention directe du budget de l’Etat
dans l’alimentation du Fonds National pour le sport.
- Le soutien public aux clubs de haut niveau, fondé sur des cahiers des charges précis.
- La relance du sport national d’élite dans les
diverses disciplines. Un plan d’actions sera dégagé, dans le but de
faire revenir graduellement l’Algérie sur la scène sportive mondiale.
Cet effort important a été renforcé pendant le dernier quinquennat. Ainsi, le secteur de la jeunesse et des sports a bénéficié, pour la période 2010-2014, d’un financement de 380 milliards de DA dédiés à la réalisation de 80 stades de football, 750 complexes de proximité, 160 salles polyvalentes, plus de 400 piscines, 3 500 aires de jeux, 230 auberges et maisons de jeunesse ainsi que plus de 150 centres de loisirs scientifiques. Actuellement, il est fait état de 73 stades omnisports, 512 complexes sportifs de proximité, 267 salles omnisports et 98 piscines. Pour l’année en cours, il est attendu un total de 83 stades omnisports, 561 complexes sportifs de proximité, 304 salles omnisports et 145 piscines.
Durant les trois mandats, le Président Bouteflika, a accordé un
intérêt particulier aux différentes disciplines sportives principalement
le football destinataire d’un appui sans précédent ayant permis la
qualification de l’équipe nationale en 2010 et 2014 à la Coupe du monde,
et cela après 24 ans d’absence.
IX – Promotion de la culture, préservation du patrimoine
La promotion de la culture, dans ses différents aspects, a été
marquée aussi bien par la réalisation de nombreuses infrastructures que
par un intérêt croissant accordé à la production, la recherche et
l'exploitation des moyens et des différents supports de publication,
d'information et audiovisuels. De ce fait, le secteur a
bénéficié pour l’essentiel :
. D’un budget d’équipement de 90 milliards DA durant
les deux premiers mandats. Le budget de fonctionnement du secteur a
accompagné cette évolution en atteignant les 15 milliards DA pour
l’exercice 2009.
. De 133 bibliothèques (dont une centaine mises en chantier durant la période), 23 maisons de culture et de 72 centres culturels.
. D’un programme pour la réalisation de près de
1.200 bibliothèques et salles de lecture au bénéfice de toutes les
communes qui en sont encore dépourvues.
. D’un programme d’ouverture de salles de lecture dans les cités et localités en collaboration avec les collectivités locales.
S’agissant du livre, la législation a été consolidée
par l’institution de deux festivals du livre, l’édition ou la réédition
de plus de 1.200 titres dans le cadre de la manifestation culturelle
«Alger capitale de la culture arabe 2007».
Le cinéma a, quant à lui, enregistré la production
de 80 œuvres en 2007. Cette opération a été accompagnée de la rénovation
de 17 salles du réseau de la cinémathèque, ainsi que de salles
communales de cinémas.
Théâtre, chorégraphie, musique et arts lyriques :
production de 47 pièces théâtrales en 2007, renforcement de la
formation artistique dans plusieurs établissements, projet de
réalisation dans la capitale d’un opéra de dimension nationale, en plus
d’un projet d’une grande salle de spectacle. Un total de 93 festivals
culturels internationaux, nationaux, et locaux a été relancé et encadré
au plan réglementaire.
Cet effort a été poursuivi lors du dernier quinquennat. Ainsi, 140 milliards de DA ont été octroyés au secteur de la culture pour la réalisation de 40 maisons et complexes culturels, 340 bibliothèques, 44 théâtres, 12 conservatoires de musique et écoles des beaux-arts ainsi que 156 centres de loisirs scientifiques.
A l’horizon 2014, une soixantaine de bibliothèques sont au programme des réalisations amenant à un total de 370. On attend également la réalisation de 5 musées, 9 théâtres et 7
instituts et écoles de formation artistique. Le cinquantenaire de
l’Indépendance a permis de financer un nombre important d’œuvres
culturelles.
Patrimoine : la préservation et la restauration
du patrimoine a fait l’objet de nombreux programmes ainsi que d’une
amélioration de la protection légale des biens culturels.
Alger a accueilli, en juillet 2009, le second Festival Culturel panafricain, et
en 2011, la ville de Tlemcen a été, durant une année, la capitale de la
civilisation islamique. Ces actions se poursuivent notamment à
Constantine, capitale de la culture arabe pour l’année 2015.
Affaires religieuses
Ce secteur a bénéficié, durant la période 2009-2013, d’un budget de plus de 120 milliards DA, en vue de la réalisation de la Grande Mosquée d’Alger et plus de 80 autres mosquées et centres culturels islamiques et 17 écoles coraniques. La restauration de 17 mosquées historiques est au programme.
X – Prise en charge de l’histoire (la mémoire) nationale
La prise en charge de ce volet s’est traduite par la constitution de
fonds bibliothécaires, la création d’ateliers dédiés à la recherche
scientifique historique englobant des domaines nouveaux aux plans de
l'utilisation technique, cinématographique et documentaire, ainsi que
l'exploitation des espaces idoines pour ériger des monuments
historiques. Elle s’est concrétisée également à travers :
. La prise en charge des droits et des besoins des Moudjahidine et ayants droits en témoignage de la reconnaissance de la Nation.
. La poursuite du programme de restauration des 800
sites et édifices liés à la lutte de libération, la réalisation des
musées de la Révolution, dont 33 ont été réceptionnés, La collecte des documents et témoignages et la production d’ouvrages sur la lutte de libération nationale.
. La mise en œuvre des dispositions
constitutionnelles relatives aux responsabilités de l’Etat dans le
domaine de la promotion de l’écriture de l’Histoire et de son
enseignement aux jeunes générations.
Les Moudjahidine
Ces 5 dernières années, le secteur des Moudjahidine a bénéficié de 19 milliards de DA en vue de la réalisation de 9 centres de repos, de salles de soins et de rééducation, 17 musées et complexes historiques ainsi que la réhabilitation de 34 sites historiques et l’aménagement de 40 cimetières de martyrs.
De 2009 à 2013, pas moins de 95 projets ont été programmés, dont l’étude et l’équipement de 10 centres de repos, la réhabilitation et l’extension de 8 centres de repos, la réalisation de 8 salles de soins et de 2 musées régionaux. Pour l’année 2014, il est prévu l’aménagement de 2 musées régionaux, la réalisation de 14 annexes de musées régionaux, la réhabilitation de 22 cimetières de martyrs, de 12 stèles ainsi que l’aménagement de 3 directions.
XI- Promotion des droits de la femme
L’égalité des droits entre les hommes et les femmes est consacrée
dans les textes de loi. La Constitution garantit cette égalité et
appelle les institutions de l'Etat à bannir toutes formes de
discrimination.
En outre, la révision constitutionnelle de novembre 2008 a consacré
de nouvelles dispositions relatives à la promotion de la place de la
femme dans les assemblées élues. L’Algérie est signataire des
conventions internationales qui protègent les droits des femmes.
La poursuite de la politique, déjà entamée, a permis la nomination de
femmes à des postes jusque-là réservés aux hommes, notamment ceux de
Wali, Ambassadeur, recteur d'université, président de Cour et membres du
gouvernement.
L’égalité des droits se traduit sur le terrain avec notamment la
participation de la femme à la vie politique, économique et culturelle.
Les réformes initiées par le Président Abdelaziz Bouteflika ont ouvert à
la femme les portes d’une représentation sans précédent au sein des
instances élues, y compris au Parlement. Ainsi, le taux de
représentation est supérieur à 30%, alors qu’il n’était que de 7%
environ lors de la précédente législature. L’autre acquis de la femme
réside en l’égalité de rémunération avec les hommes occupant les mêmes
postes et les mêmes responsabilités par rapport à d’autres pays ainsi
que d’autres droits fondamentaux issus des réformes des codes de la
nationalité et de la famille.
Solidarité nationale
Des infrastructures spécialisées sont administrées sous tutelle
du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition féminine. Ce département ministériel est doté de quarante-huit
directions de l’Action sociale et de solidarité de wilaya.
Ces infrastructures sont édifiées en vue de la prise en charge
institutionnelle des catégories vulnérables, en particulier l'enfance
privée de famille, les jeunes en «danger moral», les femmes en
difficultés sociales, les personnes handicapées (mental, moteur, auditif
et visuel), les personnes âgées dépourvues de ressources et les
personnes démunies. Cette prise en charge institutionnelle est assurée
par un encadrement spécialisé formé au niveau des trois Centres
nationaux du secteur, dont plusieurs profils de formation sont dispensés
depuis 14 ans, à savoir : les éducateurs spécialisés, les maîtres
d’enseignements spécialisés, l’assistante sociale, l’éducateur, le
technicien. En outre, en vue de la réalisation de plus de 70
établissements spécialisés au bénéfice des handicapés et près de 40
infrastructures pour les personnes en détresse, une enveloppe budgétaire
de 40 milliards de DA a été accordée au secteur de la solidarité
nationale.
Pour rappel, 184 structures spécialisées ont été érigées entre 1999
et 2013. Pour la période 2009-2013, soixante six infrastructures
spécialisées ont été réalisées et ce, à travers quarante wilayas du
pays. Il s’agit de 38 centres psychopédagogiques pour enfants handicapés
mentaux, 2 centres psychopédagogiques pour enfants handicapés moteurs, 4
écoles pour enfants handicapés visuels, 5 écoles pour enfants
handicapés auditifs, 1 centre pour insuffisants respiratoires, 1 centre
spécialisé de rééducation, 1 centre polyvalent de sauvegarde de la
jeunesse, 12 établissements pour enfants assistés, 1 foyer pour
personnes âgées, ainsi qu’un centre national d'accueil pour jeunes
filles et femmes victimes de violence en situation de détresse.
Pour la fin de l’année 2013, il est fait état au total de 353
établissements, répartis sur tout le territoire national. Il s’agit de
136 centres psychopédagogiques pour enfants handicapés mentaux répartis à
travers 48 wilayas, dont la mission est l’accueil ainsi qu’une prise en
charge en matière d’éducation et d’enseignement spécialisé d’enfants
âgés de 4 à 18 ans ayant un handicap mental, 7 centres
psychopédagogiques pour enfants handicapés moteurs, implantés au niveau
de 7 wilayas. 46 écoles d’enseignement spécialisé pour enfants
handicapés auditifs sont réparties à travers 41 wilayas, dont la mission
est l’accueil des enfants malentendants ou sourds âgés de 5 à 16 ans
afin qu’ils suivent une scolarité identique à celle de l’éducation
nationale. D’autres institutions et écoles sont réparties sur 22
wilayas. Il s’agit de 22 écoles d’enseignement spécialisé pour enfants
handicapés visuels, dont la mission est l’accueil des enfants
non-voyants ou mal voyants âgés de 5 à 16 ans, afin qu’ils suivent
une scolarité identique à celle de l’éducation nationale. 7 Centres
pour insuffisants respiratoires (CIR) sont répartis à travers 7 wilayas.
Ces établissements prennent en charge des enfants et adolescents
bénéficiant d’une scolarité ordinaire, soutenue par un programme
psychopédagogique et médical. On comptabilise également 46 centres
spécialisés en rééducation, en protection et en sauvegarde de la
jeunesse. Ils sont répartis à travers 32 wilayas, dont 9 pour l’accueil
de jeunes mineures. Ces établissements ont pour mission l’accueil de
jeunes mineurs en danger moral ou ayant commis des délits. D’autres
structures ont été érigées, dont 50 Etablissements pour enfants assistés
(dont 36 pour les 0-6 ans). Répartis à travers 38 wilayas, ces
établissements ont pour mission l’accueil des enfants sans attaches
familiales dès la naissance. Il est également fait état de 4 foyers
d’accueil pour orphelins victimes du terrorisme (FAO). Répartis à
travers 4 wilayas. Ils ont pour mission l’accueil, la prise en charge,
l’éducation et le placement, dans un milieu familial, des enfants
orphelins. 33 Foyers pour personnes âgées, répartis à travers 28
wilayas, dont la mission est l’accueil des personnes âgées de plus de 65
ans, sans soutien familial ni ressources, des personnes handicapées et
infirmes moteurs âgés de plus de 15 ans sans soutien familial ni
ressources et reconnus inaptes au travail et à une rééducation
professionnelle, ont été réalisés. 2 autres Centres Nationaux pour
Femmes Victimes de Violences ont été également érigés durant cette
période.
Pour l’année 2014, 34 établissements supplémentaires en cours
d’achèvement seront réceptionnés. Ainsi, on comptabilisera un
total de 387 établissements, soit une augmentation de 9,63% par rapport à
la période 1999-2013. Il s’agit de 4 centres psychopédagogiques pour
enfants handicapés mentaux, 3 centres psychopédagogiques pour enfants
handicapés moteurs, 4 écoles pour enfants handicapés visuels, 2 écoles
pour enfants handicapés auditifs, 2 centres pour insuffisants
respiratoires, 9 centres spécialisés de rééducation, 2 centres
polyvalents de sauvegarde de la jeunesse, 3 établissements pour enfants
assistés, 3 foyers pour personnes âgées ainsi que 2 centres nationaux
d'accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violence et en
situation de détresse.
- Prime scolaire de solidarité
Le ministère a octroyé 3 000 DA pour chaque élève issu des milieux défavorisés. Cette prime a profité à 3 millions d’élèves.
La même prime est allouée aux enfants handicapés issus de familles
démunies, scolarisés au niveau des établissements spécialisés.
Prise en charge de la femme
Alphabétisation des femmes : avec le concours de 228 associations, le ministère a permis à 80 877 femmes d’accéder aux cours d’alphabétisation entre 2011 et 2012.
Emploi des femmes : les dispositifs d’insertion sociale gérés par le secteur ont profité à 57,9% de femmes dans le cadre de l’AFS, 75,7% dans le cadre du PID et 50,5% dans le cadre du DAIS.
Prise en charge des mineurs en difficulté sociale ou en danger moral
Le secteur dispose d’un réseau
infrastructurel de 46 établissements spécialisés pour la prise en charge
des mineurs en difficulté sociale ou en danger moral. 8 665 mineurs ont été secourus en 2010 et 8 934 en 2013.
Prise en charge de la petite enfance
Le nombre de crèches et jardins d’enfants a connu une évolution significative, passant de 500 établissements en 2010 à 907 en 2013. Ainsi, 43 935 enfants ont été pris en charge en 2013 contre 11 541 en 2010.
Prise en charge des enfants privés de famille
Le nombre d’enfants pris en charge a été de 1 678 en 2013, dont 960 placés en kafala locale et 95 en kafala à l’étranger.
Prise en charge des personnes âgées
La protection des personnes âgées tel que mentionné dans l’arrêté du 13 juillet 1999, a permis la création de 36 établissements à travers le pays, accordant une place à 2 028 pensionnaires, dont 867 femmes.
Des dispositifs de protection et de bien-être des personnes âgées ont été instaurés dont :
- l’allocation forfaitaire de solidarité qui a bénéficié à 297 465 personnes en 2013
- Le microcrédit qui a bénéficié à 4 565 personnes en 2013.
- L’accueil de jour des personnes âgées dans des établissements spécialisés.
- Aide et accompagnement à domicile, 4 opérations pilotes ont été lancées à 0ran, Médéa, Tizi-Ouzou, Annaba avec la participation du mouvement associatif local.
- Des séjours aérés ont été organisés au profit de 431 personnes issues de 35 wilayas du pays.
XII- Promotion des médias, de la presse et de la communication
A/Communication
En vue de l’amélioration des équipements de radio, de télévision et de leurs réseaux de diffusion, une enveloppe de 106 milliards de DA a été allouée au secteur de la communication. Ceci a permis de concrétiser :
1/Sur le plan organisationnel
- Refonte des principaux textes régissant les établissements sous tutelle
- Actualisation et adaptation de la législation sectorielle
- Un nouveau siège du ministère de la Communication a été réalisé.
En matière de Presse écrite
Concrétisation du droit du citoyen à l’information :
- Réalisation de deux unités d’impression à Ouargla et Béchar d’une capacité de 100 000 exemplaires par jour chacune. Elles assurent actuellement l’impression d’une vingtaine
de titres. L’imprimerie de Béchar a pour mission de répondre aux
besoins de 5 wilayas du sud-ouest algérien (Béchar, Adrar, El Bayadh,
Tindouf et Naâma) en journaux et livres scolaires.
- Dans le cadre du fonds spécial du développement des régions du Sud, 4 imprimeries ont été notifiées en 2013 et sont en cours de réalisation à Tamanrasset, Illizi, Tindouf et Adrar.
Modernisation des moyens et des activités de l’Agence nationale de presse :
- Réalisation de 4 directions régionales à Constantine, Oran, Ouargla et Blida
- L’acquisition de bureaux de wilayas est en cours de réalisation
- Durant la période 2010-2014, il y
a eu le renouvellement de la plateforme rédactionnelle multimédia et la
mise en place d’un Progiciel ERP (entreprise ressources planning)
- Renouvellement de la plateforme rédactionnelle en diffusant des informations par téléphone (MOB-APS).
En matière de Télédiffusion
- Elargissement et amélioration de la couverture du territoire national en programme radiophonique et télévisuel :
- Réalisation de nouveaux centres de diffusion, renouvellement
des principales stations d’émissions radio FM ainsi que l’acquisition,
l’installation et la mise en service de stations d’émissions et de
réémissions sur l’ensemble du territoire national en vue de diffuser 4 programmes radio FM simultanément et la diffusion radio de 6 programmes par sites de diffusion.
- Renouvellement des équipements d’émissions des centres ondes courtes, moyennes et longues.
- Installation d’1 réémetteur par site pour chaque chaîne radiodiffusée.
- Développement du réseau de diffusion et des programmes radiophoniques et télévisuels destinés à l’étranger.
- Mise en place d’un réseau de télévision numérique terrestre (TNT) :
- Mise en service de 3 premières stations (Chréa, Kal El Akhal et Tassala) en 2010, puis 93 stations de différentes puissances et 100 stations de réémissions pour la résorption des zones d’ombre. Ce réseau couvre 60% de la population. Il atteindra les 90% à la fin 2014 avec, notamment :
- La mise en service de 15 plateformes de codage et multiplexage pour les réseaux des Hauts-Plateaux.
- Le développement et le renforcement des moyens de sécurité pour la protection du patrimoine.
- L’amélioration et l’extension de la couverture radiophonique et télévisuelle dans le cadre du programme des Hauts-Plateaux.
- L’amélioration et l’extension de la couverture radiophonique et télévisuelle dans le cadre du programme du Sud.
- Le remplacement des équipements arrivés en fin de vie opérationnelle
et mis à profit pour tirer parti des techniques numériques qu’offrent
les nouveaux systèmes de diffusion et de transmission.
En matière de télévision
- Renforcement des moyens de production de programmes télévisuels en
orientant l’investissement vers la technologie numérique :
- Il a été procédé à l’acquisition, pour les 5
chaînes ainsi que pour les stations régionales (Constantine, Oran,
Ouargla, Béchar), d’un ensemble de moyens de production fixes et mobiles
(Caméscopes, unité de postproduction, unités mobiles et de reportages).
- La réalisation et l’équipement de la maison de la télévision
- La création de chaînes de télévision thématiques :
- 2 chaînes de télévision la TV4 (Tamazight), TV5(Coran) ont été lancées en 2009.
- Développer et diversifier les programmes télévisés.
- La réalisation et/ou l’aménagement des centres régionaux de télévision :
- Des centres implantés à Ghardaïa, El Oued, Tindouf, Adrar et Illizi sont en cours de réalisation.
- L’entretien et la réhabilitation des moyens et infrastructures d’environnement dont la vétusté menace la continuité du service.
En matière de radiodiffusion sonore
- Le renforcement des moyens de production des programmes
radiophoniques en orientant l’investissement vers la technologie
numérique :
- Initié durant la période 2005-2009 pour les chaînes radiophoniques
nationales et thématiques, cette action a été généralisée à l’ensemble
des chaînes de proximité.
- Acquisition et mise en service de système de radios numériques pour 15 stations de radios locales et thématiques.
- Création de radios locales dans chacune des wilayas.
- Développement et diversification des programmes radiophoniques.
- Création de chaînes de radios thématiques :
- Une radio destinée à la jeunesse a été réalisée.
- Acquisition d’équipements pour le service Radio Internationale.
Actions liées aux médias
Presse écrite :
Entre 2009 et 2013 :
- le nombre de quotidiens est passé de 78 à 142.
- Le nombre d’agréments des nouveaux titres a été de l’ordre de 36 en 2012 et de 39 en 2013.
Actions liées au renforcement de la liberté d’expression et de presse
Deux importants textes de loi ont été promulgués dont la loi relative
à l’information en 2012, ainsi que la loi relative à l’activité
audiovisuelle en 2014.
Action liées à la formation
La formation des personnels des médias a connu une évolution durant la période 2009-2013. Elle est passée de 1 069 personnes à 1 284, soit un total de 5 644 personnes formées.
B/ Les Technologies de l’information et de la communication (TIC) :
Le secteur de la Poste et des TIC s’est renforcé par la réalisation
des infrastructures socioéconomiques au titre de 2009-2013. Il s’agit de
733 infrastructures de télécommunications fixes, de 9 676 d’infrastructures de télécommunications mobiles, de 12 infrastructures spatiales et 7 de contrôle des fréquences. La même période a enregistré la réalisation de 52 infrastructures commerciales de télécommunications, de 308 infrastructures postales et 3 parcs technologiques. Il est à souligner que 100 milliards de DA ont été réservés à la «E gouvernance»
L’année 2014 verra la réalisation de 270 infrastructures de télécommunications fixes et de 3 351 mobiles. En plus des 2 infrastructures de télécommunications spatiales, de 12 infrastructures de contrôle des fréquences, 240 infrastructures commerciales de télécommunications et 189 postales ont été réalisées. Ceci, nous donne un total général de 14 855 infrastructures réalisées durant ce dernier quinquennat en y incluant les prévisions pour 2014.
Enfin, pour permettre la généralisation de l’Internet, la technologie
3G a été lancée le 14 décembre 2013, après un appel à concurrence
adressé aux trois opérateurs.
XIII : Les acquis de la diplomatie algérienne
Depuis 1999, la diplomatie algérienne, dirigée par Abdelaziz
BOUTEFLIKA, a su briser l'isolement dans lequel le pays était confiné
durant la décennie du terrorisme et retrouver sa place qui est la sienne
sur la scène internationale.
Une présence forte et active dans les forums internationaux a permis à
notre pays de contribuer ainsi à la recherche de solutions aux défis
multiples imposés à la communauté internationale, dont le terrorisme, la
sécurité et le désarmement, la problématique du développement, la
protection de l'environnement et le dialogue des civilisations.
C'est dans la foulée de ces mutations profondes que, sous l'impulsion
du président de la République, le ministère des Affaires étrangères a
initié un redéploiement de ses structures au niveau central et à
l’extérieur pour assurer une meilleure prise en charge des intérêts
géostratégiques et économiques du pays et se mettre en permanence à
l'écoute de la communauté nationale à l’étranger.
Forte de ses importants acquis, la politique extérieure arrêtée et
conduite par M. le Président de la République, a permis à notre pays de
conforter sa place dans le concert des nations, en dépit d’un contexte
régional et mondial complexe, marqué par des défis politiques (printemps
arabe), sécuritaires (Sahel), économiques (crise financière et
économique dont les effets perdurent) et environnementaux considérables
(l’Afrique subissant les plus grands dommages).
Le Maghreb arabe : l’Algérie, profondément attachée
au choix stratégique d’un ensemble régional cohérent et complémentaire
permettant de faire droit aux aspirations de tous les peuples de la
région, et empruntant des voies méthodiques qui prennent en charge les
mutations intervenues aux plans régional et international, ne saurait
admettre que cet ensemble maghrébin se construire au détriment du peuple
sahraoui et de ses droits légitimes et inaliénables à
l’autodétermination, en référence à la résolution 1514 des Nations unies
sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples colonisés.
L’Algérie, qui œuvre pour des relations apaisées avec son voisin de
l’Ouest, soutient les efforts du Représentant personnel du Secrétaire
des Nations unies pour la promotion d’une solution juste et durable de
la question du Sahara occidental, conformément aux résolutions
pertinentes du Conseil de Sécurité et à la légalité internationale. Elle
soutient aussi les efforts de tous ceux qui appellent à l’élargissement
du mandat de la MINURSO à la protection des droits de l’homme dans les
territoires sahraouis occupés.
A propos de la question des droits de l’homme, l’Algérie vient d’être
élue membre du Conseil des droits de l'homme de l’ONU, preuve de
l’appréciation internationale positive des droits de l’homme en Algérie.
Le monde arabe : l’Algérie a œuvré au renforcement
de la cohésion et de la solidarité arabes, et n’a eu de cesse d’appeler à
la concrétisation de l’exigence d’une action arabe commune. La
nécessité de la réalisation des aspirations des peuples et des pays
arabes, du respect de leurs droits légitimes à la justice, à la dignité
et à la stabilité, a également constitué un axe important de l’action de
notre pays. L’Algérie a ainsi manifesté une solidarité sans faille pour
l’édification d’un Etat palestinien avec pour capitale El Qods Echarif
et pour l’admission de la Palestine en qualité de membre de l’ONU.
L’Algérie, qui est pour la libération de tous les territoires arabes
occupés en 1967, considère que l°initiative arabe de paix demeure le
référent adéquat pour le règlement de cette question.
D’une manière générale, au sein de la Ligue des Etats arabes,
l’Algérie a joué un rôle stabilisateur, adoptant une position conforme à
ses principes de non-ingérence et œuvrant en faveur de l’unité des
rangs arabes et de la sauvegarde de la souveraineté et de l’intégrité
des pays membres de cette organisation.
L’Afrique : L’Algérie a appuyé tous les efforts en
vue de résoudre les conflits et les différends qui secouent notre
continent, et de promouvoir le développement et l’intégration du
continent, ainsi que son insertion ordonnée et bénéfique dans la
mondialisation.
Dans le cadre de l’Union africaine (UA), l'Algérie, membre fondateur
et l’un des principaux contributeurs au budget de cette organisation
régionale, joue un rôle de premier plan par ses initiatives et
propositions, particulièrement lors des sommets des Chefs d'Etat, où la
participation de notre pays a toujours été soutenue et active, lui
valant la reconnaissance, au plus au haut niveau, des dirigeants des
principaux partenaires de l’Afrique, tels que ceux du G8, dont l’Algérie
est devenue l’un des interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui
concerne notre continent.
Dans la région du Sahel, l’Algérie a fortement contribué à
l’établissement, en 2010, du Comité d’Etat-major opérationnel conjoint
(CEMOC) des pays du Champ et de la Force africaine en attente. Celle-ci
devrait être effective à la fin de 2015 et autoriserait le recours à la
force ou à une intervention rapide pour le règlement de certaines
crises. De même, l’Algérie a œuvré pour la promotion d’une stratégie
intégrée prenant en compte l’impératif d’une réponse coordonnée des pays
du Champ aux menaces à la sécurité dans la sous-région, ainsi qu'aux
besoins essentiels des populations démunies. Ces efforts couronnés,
notamment, par la tenue à Alger, en septembre 2011, d’une conférence sur
le partenariat, la sécurité et le développement entre les pays du Champ
(Algérie, Mauritanie, Mali et le Niger), devraient être confortés par
l’apport d’un partenariat international authentique en soutien à cette
stratégie basée sur l’appropriation de la sous-région par ses pays
eux-mêmes.
L’Algérie a, par ailleurs, appuyé le dialogue national et le
processus électoral au Mali, visant à donner une assise solide à la
reconstruction des institutions de ce pays, comme elle a soutenu la
réunion autour d’une même table des différentes parties syriennes, afin
de trouver une issue pacifique au conflit qui déchire ce pays frère.
Outre sa contribution à la résolution des conflits, l’Algérie a
participé à des conférences internationales pour venir en aide à des
pays voisins et à des pays frères, confrontés à des situations
humanitaires dramatiques causées et/ou aggravées par des conflits
internes (Mali, Syrie, Yémen, Libye), ou encore du fait de catastrophes
naturelles (Philippines, Soudan) et autres (Congo).
En matière de développement de l’Afrique, l’Algérie s’est pleinement
engagée dans la promotion et la mise en œuvre du NEPAD, qu'elle a initié
avec d’autres partenaires africains, notamment l’Afrique du Sud et le
Nigeria ; de même qu’elle a été l'un des premiers à adhérer au Mécanisme
d’Evaluation par les Pairs (MAEP), et a, après une évaluation globale
effectuée en 2007, soumis en 2009 un rapport d’étape concernant son
programme d’amélioration de la gouvernance, suivi d'un deuxième rapport
en 2012. Cette démarche découle du fait que notre pays ne peut concevoir
un développement harmonieux sans une bonne gouvernance et sans une
intégration économique continentale plus forte.
L’Algérie, qui a atteint, avant la date-butoir, les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD), entend prendre une part active
dans la définition du cadre rénové des OMD pour la période post-2015.
Parce que le développement durable est un facteur déterminant pour
une intégration réussie de notre continent et de son insertion
avantageuse dans une mondialisation effrénée de l’économie, l’Afrique
bénéficiera de la formation des ressources humaines qu’assurera
l’institut des Nations unies dédié au développement durable qui sera
implanté à Alger et sera opérationnel à la fin de l’année 20l4. Dans ce
même ordre d’idées, la conférence africaine sur l’économie verte, qui
s’est tenue à Oran en février 2014, permettra de favoriser la transition
vers une économie verte fondée sur les priorités nationales du
développement durable.
Les autres régions : l’Algérie a poursuivi le
raffermissement de ses relations bilatérales avec l’Europe -la
coopération traditionnelle avec les anciens pays du bloc socialiste a
été relancée et renforcée et son cadre juridique adapté -, mais aussi
avec l’Asie et les pays de l’Amérique latine avec lesquels existent de
solides liens d’amitié et de coopération.
L’action diplomatique de l’Algérie a été mise à contribution pour
accompagner le développement de l'économie nationale (mise à niveau et
adaptation de l'outil de production aux techniques modernes de
production et de gestion en appui aux efforts des agents économiques
nationaux), à travers l’encouragement de l’investissement et du
partenariat étrangers. Cette démarche a notamment bénéficié à la
mise en œuvre du plan quinquennal de développement 2010-2014. Ainsi,
l’Accord d’association avec l’UE, qui a fait l’objet de démarches de la
part de la diplomatie algérienne pour introduire un aménagement du
calendrier de mise en œuvre en rapport avec l’évolution de l’économie
nationale, a été complété par l'établissement, en juillet 2013, d’un
partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie.
Au plan bilatéral, la coopération avec nombre de nos partenaires a
été renforcée et élargie dans le cadre des traités d’amitié, de bon
voisinage et de coopération, signés avec l'Espagne (2002) et le Portugal
(2005), et du partenariat stratégique avec la Russie (2010), ainsi qu’à
la faveur de la mise en œuvre de la Déclaration d’Alger (2012) sur le
partenariat entre l’Algérie et la France. La coopération avec la Chine
est appelée à s’intensifier grâce au partenariat stratégique global,
conclu avec ce pays en février 2014.
Au niveau multilatéral, les négociations que mène l'Algérie en vue de
son accession à l’0MC appellent une contribution qualitative de notre
appareil diplomatique aux plans bilatéral et multilatéral pour
l’aboutissement de ce processus dans les meilleures conditions.
Questions de sécurité internationale : l’Algérie,
membre actif du Forum mondial contre le terrorisme, mis en place à New
York en septembre 2011, a contribué à l’efficacité accrue de la
coopération internationale dans la lutte contre ce fléau, à travers le
dialogue stratégique établi avec les USA (2012) et le partenariat
stratégique de sécurité noué avec le Royaume uni (2013).
L’Algérie a joué un rôle important dans la sensibilisation de la
communauté internationale pour le parachèvement de l’architecture légale
contre le terrorisme, dont un des effets directs est l’adoption d’une
résolution onusienne demandant aux Etats membres de ne pas verser de
rançon financière ou politique aux terroristes en cas de prise d’otages.
Sous l`impulsion de l'Algérie, l’Afrique s’est dotée d'une convention
pour la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée à
l’occasion du 35e sommet de l’OUA, à Alger en 1999. Dans le
cadre de la mise en œuvre de cette convention et en application du plan
d’action de l’UA pour la prévention et la lutte contre le terrorisme,
adopté à Alger en 2002, un Centre africain d’études et de recherche sur
le terrorisme (CAERT) a été établi à Alger. En accueillant ce centre,
l’Algérie met à la disposition de l’Afrique ses moyens et son expérience
dans la lutte antiterroriste.
En matière de désarmement, et plus particulièrement au sujet du
nucléaire, l’Algérie qui est signataire de toutes les conventions
internationales interdisant la prolifération nucléaire, défend le droit
légitime des Etats à l'utilisation de la technologie nucléaire à des
fins pacifiques et se réjouit du règlement du différend lié au programme
nucléaire iranien et de de la signature de l’accord y afférent.
L’Algérie a participé activement dans les divers forums de dialogue
et de concertation, tels que le dialogue méditerranéen de l’OTAN,
l’OSCE, l’UPM, les 5+5 et les autres conférences et réunions traitant
des questions de sécurité, de développement et de migration.
Le règlement pacifique des conflits, le renforcement de la
coopération internationale pour le développement, le dialogue des
cultures et des civilisations sont des thématiques constantes de
l'action internationale de notre pays. Ces questions nécessitent un
traitement adéquat par la communauté internationale dans le cadre d’un
système de sécurité collective et de coopération rénové.
A cet égard, l’Algérie qui plaide pour une réforme profonde du
système des Nations unies, apporte sa contribution active à toutes les
initiatives tendant à remodeler les cadres et les pratiques de
gouvernance mondiale, afin de les rendre plus démocratiques et plus
équitables.
REALISATIONS EN FAVEUR DE LA COMMUNAUTE NATIONALE ETABLIE A L'ETRANGER
La communauté nationale à l’étranger a toujours été une
préoccupation majeure de l'Etat Algérien. Le programme du Président de
la République consacre cet objectif. Il marque l'intérêt de l’Algérie
pour les nationaux résidant à l’étranger et fixe les priorités en la
matière.
1-Gestion consulaire et administrative
- Des mesures de fond ont été prises pour faciliter davantage les
formalités d'immatriculation consulaire, de délivrance de documents
administratifs, ainsi que la simplification des procédures d'obtention
de ces derniers.
- Garantie du meilleur accueil possible dans les enceintes des
consulats et ambassades et réduction du nombre de pièces constitutives
des dossiers administratifs et des délais de leur traitement.
- Réduction du coût fiscal du passeport algérien (de 60 à 20 euros) et autres documents soumis à légalisation.
- Numérisation de l’état civil des membres de la communauté nationale,
tant au siège du Ministère qu'au niveau des représentations à
l'étranger afin de faciliter grandement l'obtention de ces documents par
voie électronique auprès du Registre National de l'Etat Civil.
- Aménagement d’espaces d'accueil adéquats et acquisition de nouveaux
locaux diplomatiques et consulaires : chancelleries à Lyon, Montpellier,
Toulouse, Grenoble, Nice, Nanterre, Pontoise, Vitry-sur- seine,
Alicante, Londres et Frankfort. Le programme doit s'étendre à d'autres
pays où vit une forte communauté nationale.
- Possibilité de délivrance des passeports de courte durée (une année)
a été donnée aux postes diplomatiques et consulaires afin de permettre à
certains nationaux de régulariser leur situation sur le plan du séjour.
- Facilités accordées pour l'obtention du passeport ordinaire et
depuis 2013 du passeport biométrique. Des options ont été retenues pour
permettre la délivrance en Algérie de l'acte de naissance 12 s, comme a
été généralisée l'obtention du casier judiciaire en ligne.
- Mise en place d'un système informatique entre le MAE et le MDN en vue de la gestion du Service national à l’étranger.
2- protection judiciaire et consulaire
- Généralisation de la conclusion de conventions avec des Avocats conseils dans le cadre de l'assistance judiciaire.
- Renforcement des visites consulaires aux détenus algériens pour
s'enquérir de leur situation carcérale et s'assurer du respect de leurs
droits.
- Visites aux centres de rétention où sont signalés de potentiels citoyens algériens.
- Aide au retour volontaire des nationaux en situation irrégulière.
- Visites aux malades et personnes âgées dans les foyers pour les «chibanis».
- Démarches officielles pour veiller au respect des conventions
bilatérales sur le séjour des Algériens et dans le cadre des accords de
réadmission signés par notre pays.
- Traitement et règlement définitif des dossiers de demandes de
bénéfice des dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation
nationale.
3- opérations de rapatriement
Le MAE a organisé trois opérations lourdes de rapatriement de
nationaux se trouvant dans les pays connaissant de graves troubles
internes.
- Rapatriement par voies aérienne et maritime de milliers de nationaux
de Libye, de Syrie, d`Egypte et du Japon (accident nucléaire). Des
moyens matériels, financiers et humains ont été mobilisés à cette fin.
- Rapatriement de citoyens en détresse dans d'autres pays, dont
récemment une famille de 15 personnes à partir de la République de
Centrafrique.
- Conduite de l'opération qui a permis le retour au pays, à partir du Kenya, des 17 marins enlevés sur le bateau «le Blida».
- Libération et rapatriement de certains détenus en Irak et de Guantanamo.
4- Rapatriement des dépouilles mortelles
- Prise en charge du rapatriement des corps des Algériens démunis, décédés à l’étranger.
- Mise en place d'une assurance «obsèques» moyennant une cotisation
symbolique de (25 euros par personne et par an et ne dépassant pas les
90 euros pour une famille nombreuse).
5- Portail des compétences nationales à l'étranger
- Mise en place de ce Portail en liaison avec le Ministère des Postes
et des Technologies de l'Information et de la Communication. Il permet à
ces compétences de participer à l'effort de développement national et à
réaliser des projets en Algérie.
- Renforcement des liens avec ces compétences et d'autres catégories socioprofessionnelles.
- Encouragement en vue du développement des mouvements associatifs algériens à l’étranger.
6- Encadrement scolaire, enseignement à distance
- Accompagnement des institutions nationales chargées de l'enseignement de la langue arabe à l’étranger (Ecole nationale à Paris).
- Assistance aux programmes de l'enseignement de la langue et de la
culture d'origine et encouragement des initiatives privées (associations
et mosquées).
- Programme à distance de l'enseignement de la langue arabe.
- Acheminement et distribution de manuels scolaires à l’étranger.
- Organisation d'Universités d'hiver et d'été.
7- Encadrement religieux
- Assistance à la Grande Mosquée de Paris, ses affiliés et les associations cultuelles algériennes à l'étranger.
- Assistance et aides pour la construction des mosquées, détachement permanent d'Imams et lors des périodes du Ramadhan.
- Aide de la Baâtha du Hadj aux nationaux à l’étranger effectuant le pèlerinage.
8. questions sociales
- Amélioration des conditions d'accueil aux points d'accès au territoire national.
- Aide occasionnelle aux familles nécessiteuses dans certains pays (Maroc, Tunisie, Yémen, Syrie, etc.).
- Aide à l'adoption (kafala) au profit des familles algériennes établies à l'étranger.
- Organisation de colonies de vacances en Algérie pour les enfants issus de l'immigration.
- Renforcement des liaisons aériennes et maritimes lors des périodes estivales.
- Ouverture de nouvelles lignes aériennes (France, Amérique du Nord,
monde arabe et Afrique) et programmation de nouvelles escales.
- _____________________________________
(*) Note :
Le Prophète (SAWS) n'a-t-il pas déclaré à leur propos ?
مازال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب


 انتقد جلول حجيمي، منسق النقابة الوطنية للائمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية الأحكام التي صدرت ضد الراقي أبو مسلم بلّحمر، معتبرا أن سنة سجنا نافذا شيء مبالغ فيه، في الوقت الذي يمارس السحرة والمشعوذون والدجّالون أعمالهم "المضللة" في العلن من دون تحرّك السلطات المعنية، فالمفروض -حسب المتحدّث- أن يؤخذ أمر الرقية الشرعية بجدّية وأن تنظّم ويضيّق الخناق على السحرة والدجّالين لا على "الرقاة"، ذلك أنّ الشعب الجزائري بفطرته يرتاح وهو يعالج بكتاب الله والآذكار الشرعية، مؤكّدا بأنّهم لا يقبلون أن يهان أحد، لأنّه يعالج بالقرآن الكريم، كما فعل مع بلّحمر؛ الذي وإن كنّا نطالبه بالامتثال لقوانين الصّحة - يكمل حجيمي - وأن لا يدخل في تجاوزات قانونية تضر به، إلا أنّ ما صدر في حقّه غير مقبول، ليطالب يتخفيف الأحكام ضدّ المعني بأن تكون كإنذار وتحذير له، وأن تسلّط أقصى العقوبات على أهل الدجل والشعوذة الذين يمارسون أعمالهم على المباشر
انتقد جلول حجيمي، منسق النقابة الوطنية للائمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية الأحكام التي صدرت ضد الراقي أبو مسلم بلّحمر، معتبرا أن سنة سجنا نافذا شيء مبالغ فيه، في الوقت الذي يمارس السحرة والمشعوذون والدجّالون أعمالهم "المضللة" في العلن من دون تحرّك السلطات المعنية، فالمفروض -حسب المتحدّث- أن يؤخذ أمر الرقية الشرعية بجدّية وأن تنظّم ويضيّق الخناق على السحرة والدجّالين لا على "الرقاة"، ذلك أنّ الشعب الجزائري بفطرته يرتاح وهو يعالج بكتاب الله والآذكار الشرعية، مؤكّدا بأنّهم لا يقبلون أن يهان أحد، لأنّه يعالج بالقرآن الكريم، كما فعل مع بلّحمر؛ الذي وإن كنّا نطالبه بالامتثال لقوانين الصّحة - يكمل حجيمي - وأن لا يدخل في تجاوزات قانونية تضر به، إلا أنّ ما صدر في حقّه غير مقبول، ليطالب يتخفيف الأحكام ضدّ المعني بأن تكون كإنذار وتحذير له، وأن تسلّط أقصى العقوبات على أهل الدجل والشعوذة الذين يمارسون أعمالهم على المباشر
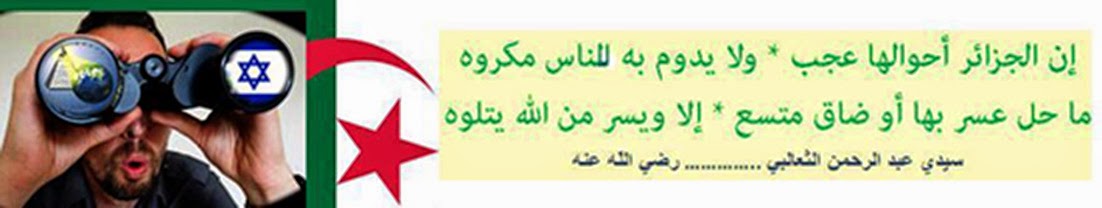


+%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%83%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87!+2.jpg)


